BATTLE OF THE SEXES DE JONATHAN DAYTON ET VALERIE FARIS
BATTLE OF THE SEXES

La reconstitution d’un match de tennis, symbole de la lutte féministe des années 70… mais où il n’est question ni de tennis ni de féminisme. Cherchez l’erreur.
Réalisateurs : Jonathan Dayton – Valerie Faris
Acteurs : Steve Carell, Andrea Riseborough , Emma Stone
Scénario : Simon Beaufoy
Direction artistique : Alexander Wei
Décors : Judy Becker
Costumes : Mary Zophres
Photographie : Linus Sandgren
Montage : Pamela Martin
Musique : Nicholas Britell
Production : Danny Boyle, Christian Colson et Robert Graf
Distributeur : 20th Century Fox
Date de sortie : 22 novembre 2017
Durée : 2h01mn

D’après une histoire vraie. 1972, Billie Jean King, championne de tennis, titulaire de trois titres du Grand Chelem, s’engage pour l’égalité des hommes et des femmes, à commencer par le respect sur les courts de tennis. C’est alors que l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs, notoirement misogyne et provocateur, lui lance un défi : l’affronter en match simple…

Après le triomphe de Little Miss Sunshine en 2006, le Valerie Faris et Jonathan Dayton avaient déjà subi un revers sévère avec l’échec commercial de leur Elle s’appelle Ruby en 2012, mais retentent ici leur chance en reconstituant un affrontement sportif qui, en 1971, marqua une date importante dans la lutte pour l’égalité entre hommes et femmes.

Il s’agit du match de tennis entre la numéro 1 mondiale Billie Jean King et l’ancien champion Bobby Riggs. Dans le rôle de ce grand provocateur borderline, le choix de Steve Carell semblait une évidence. Retrouver Emma Stone dans la peau de la tenniswoman est toutefois bien plus surprenant, tant sa récente carrière semblait l’avoir enfermée dans une image glamour qu’elle semble ici s’amuser à casser.

La présence de ces deux acteurs populaires ne suffit toutefois pas à assurer au film un quelconque succès. En revanche, il aurait pu être intéressant de découvrir par quelle approche les deux réalisateurs ont abordé la thématique, peu exploitée au cinéma, du féminisme sportif.

Tandis que le film commence, et que l’on suit parallèlement les deux futurs rivaux, tout semble indiquer que le scénario va chercher à comprendre quel mécanisme les a menés vers ce match d’exposition. Pourtant, le peu d’informations données sur les deux protagonistes, dans cette exposition, laisse les enjeux du film assez abstraits.

Après quoi, le long-métrage donne de moins en moins de place au rôle de Carell, préférant se concentrer sur les personnages féminins, le renvoyant vers un manichéisme tout ce qu’il y a de plus consensuel. Une seule certitude apparaît cependant de ces premiers instants : il ne s’agit pas du tout d’une comédie. Même si les couleurs outrancièrement bariolées des décors et costumes peuvent prêter à sourire, le ton humoristique n’est pas ce que recherchent les réalisateurs.

Les enjeux sportifs ne sont pas non plus leur centre d’intérêt puisqu’il faudra attendre pas moins d’une heure pour assister à la première scène de match de tennis. Alors que Borg/McEnroe, qui sort le même mois, expose bien plus aisément le potentiel cinégénique de ce sport, la façon dont il est filmé ici, toujours à distance, exactement comme à la télévision, rend ces passages, dont le soi-disant climax, terriblement maussades.

Peu importe, puisque ceux-ci ne représentent au final pas plus d’une quinzaine de minutes sur l’ensemble des deux heures film. Le sujet du féminisme ne semble pas non plus intéresser le scénariste Simon Beaufoy (Full Monty, Slumdog millionnaire). L’image qu’il donne de ces sportives obsédées par leurs tenues est même quelque peu sexiste.

En l’absence d’enjeux sportifs, l’unique intrigue qui anime cette première heure très verbeuse est liée à l’homosexualité non assumée de son héroïne. Le suspense ne repose que sur la crainte de Billie Jean King que son mari découvre qu’elle le trompe avec sa coiffeuse. Pourtant, la scène où ces deux derniers se croisent ne parvient pas à susciter de réelle tension.

Ce déficit est symptomatique d’une réalisation qui, dans son ensemble, manque cruellement de rythme et d’intensité. Celles-ci ne naîtront que lors des quelques effets de montage mettant en parallèle l’entraînement de King d’un côté et les provocations graveleuses de Riggs de l’autre. De courts passages qui se comptent sur les doigts d’une main mais dans lesquels on retrouve le cabotinage de Carell qui a pu permettre aux distributeurs de vendre le film comme une fantaisie comique.

Au bout du compte, et malgré l’artificialité clinquante de la direction artistique, Battle of Sexes est un film austère et surtout un récit complètement hors-sujet. Le pamphlet LGBT – car c’est exactement ce que l’ultime réplique nous rappelle ouvertement qu’il est – aurait tout eu à gagner de se faire en dehors de l’univers du tennis féminin.

Quant à la place faite à la thématique de la libération des femmes, elle ne se justifie qu’à la condition d’adhérer à cette idée foncièrement misogyne que le lesbianisme serait une inévitable dérive du féminisme. A côté de la plaque du début à la fin.
![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-300x194.png)
![Super Charlie de Jon Holmberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Super-Charlie-affiche2-100x75.png)
![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-100x75.jpg)

![The Brutalist de Brady Corbet [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Brutalist-affiche-100x75.jpg)
![Red Bird de Alexandre Laugier, Thomas Habibes et Houssam Adili [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Red-Bird-affiche-100x75.jpg)
![Greenland : Migration de Ric Roman Waugh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Greenland-Migration-affiche-100x75.jpg)

![PRIMATE de Johannes Roberts [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Primate-affiche-100x75.jpg)









![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-300x194.jpg)

![Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés de Rian Johnson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Wake-Uo-Dead-man-affiche-100x75.jpg)
![Troll 2 de Roar Uthaug [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Troll2-affiche-100x75.jpg)
![Jay Kelly de Noah Baumbach [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Jay-Kelly-affiche-100x75.jpg)
![Train Dreams de Clint Bentley [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Train-Dreams-affiche-100x75.jpg)
![Le Fils de Mille Hommes de Daniel Rezende [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Le-fils-de-mille-hommes-affiches-100x75.jpg)
![Frankenstein de Guillermo Del Toro [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Frankenstein-affiche-100x75.jpg)

![Carol de Todd Haynes [édition limitée]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Carol-01-100x75.png)
![Eddington d’Ari Aster [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Eddington-affiche-100x75.jpg)

![Thunderbolts* de Jake Schreier [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/09/Thunderbolts-affiche-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Dahomey de Mati Diop](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/06/1695-100x75.jpg)
![Here de Robert Zemeckis [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/03/Here-affiche-100x75.jpg)
![Die Alone de Lowell Dean [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/02/Die-Alone-affiche-100x75.jpg)





![Until Dawn: La mort sans fin de David F. Sandberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/05/Until-Dawn-affiche-100x75.jpg)

![Minecraft, le film de Jared Hess [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/04/Minecraft-Affiche-100x75.png)
























































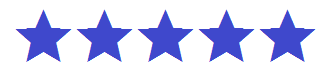






























![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/11/18337428_120332000609910654_1254544363_n1-3.png)


![18360639_120332000649417132_900260586_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/11/18360639_120332000649417132_900260586_n1.png)







![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-100x75.png)

