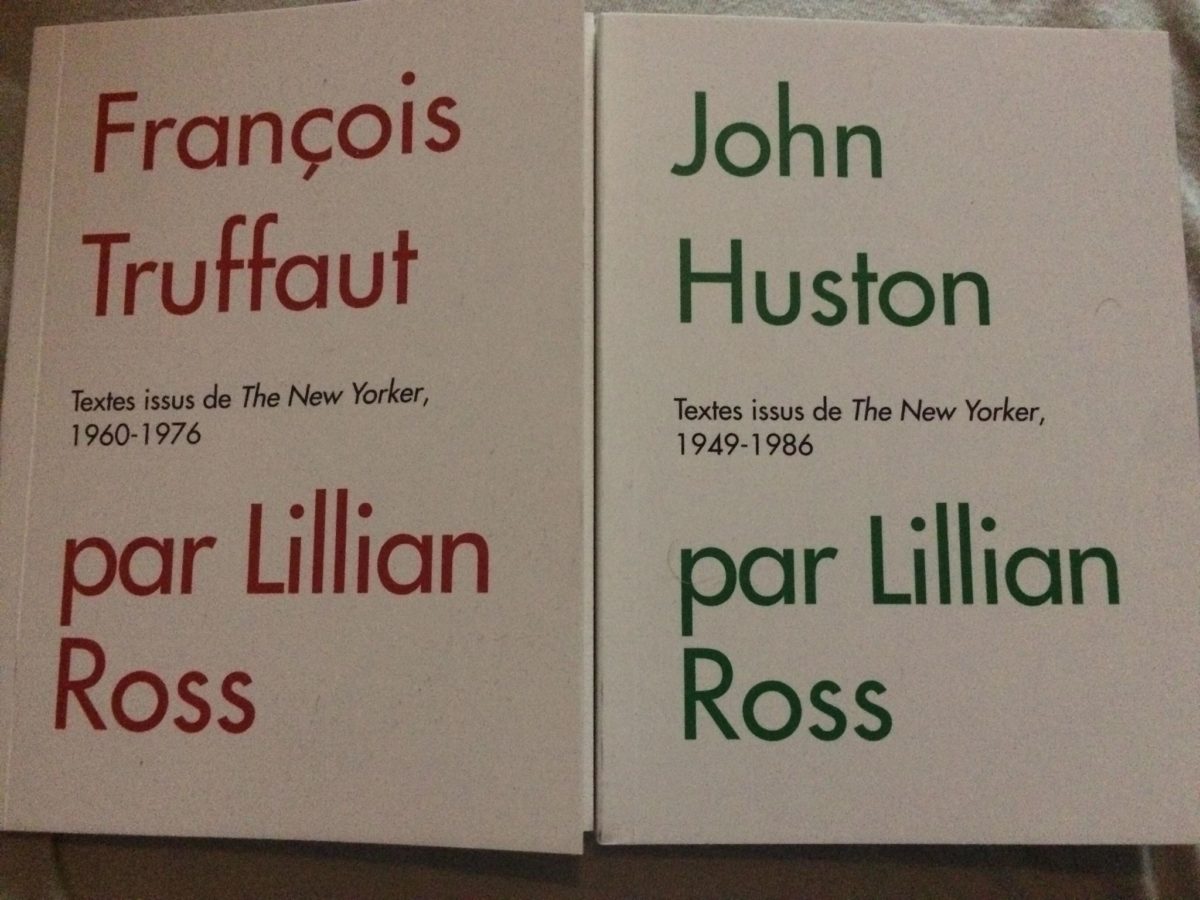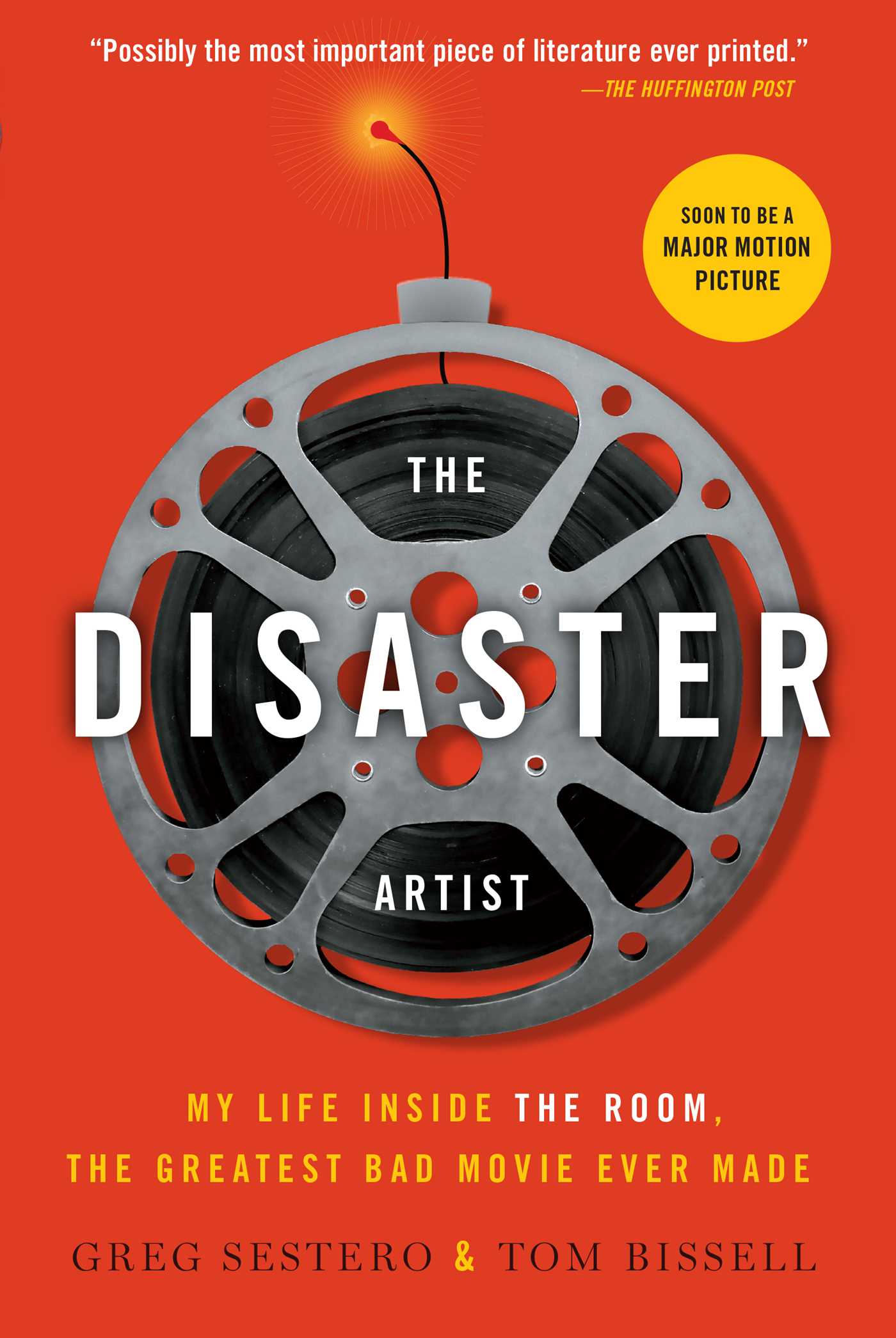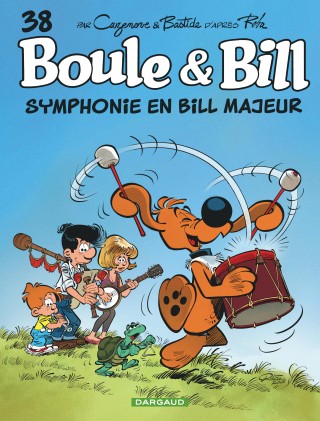COCO
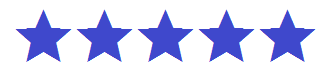

Après avoir vu Coco, vous ne verrez plus jamais votre famille ni n’irez visiter vos morts de la même façon. Un chef-d’œuvre d’humour et de mélancolie.
- Réalisation : Lee Unkrich, Adrian Molina
- Scénario : Lee Unkrich, Jason Katz, Matthew Aldrich, Adrian Molina
- Image : Matt Aspbury, Danielle Feinberg, Sharon Calahan
- Décors : Harley Jessup
- Production : Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
- Interprétation : (voix originales 🙂 Anthony Gonzalez (Miguel), Gael García Bernal (Héctor), Benjamin Bratt (Ernesto de la Cruz), Renée Victor (Abuelita Elena), Ana Ofelia Murguía (Mamá Coco), Alanna Ubach (Mamá Imelda), Alfonso Arau (Papá Julio), Selene Luna (Tía Rosita), Dyana Ortellí (Tía Victoria), Herbert Siguenza (Tío Felipe et Tío Oscar), Jaime Camil (Papá Enrique), Sofía Espinosa (Mamá Luisa), Edward James Olmos (Chicharrón)…
- Date de sortie : 29 novembre 2017
- Durée : 1h49

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

Coco, c’est le prénom de l’arrière-grand-mère de Miguel, jeune garçon mexicain, fils de fabricants de chaussures et passionné de musique. À Santa Cecilia, où il vit avec sa famille, tout le monde s’active. Dans quelques heures sera célébré El dia de los muertos, grande fête culturelle durant laquelle les familles rendent hommage à leurs morts en dressant pour eux des autels couverts d’offrandes et surmontés des portraits de leurs ancêtres.

C’est aussi à cette occasion qu’est organisé, sur la Grande Place de Santa Cecilia, un concours de musique à la mémoire d’Ernesto de la Cruz, star de la chanson et du cinéma et idole de Miguel, qui rêve de devenir musicien. Seul souci, la musique est de sa famille depuis trois générations. La faute à Mama Imelda, la mère de Coco, délaissée par un mari ayant préféré la vie d’artiste à la vie de famille.

Après que Mama Imelda, sa grand-mère, lui a cassé sa guitare et formellement interdit de participer au concours de musique, Miguel s’enfuit et décide de s’introduire dans le monument honorifique d’Ernesto de la Cruz pour jouer quelques notes avec la guitare qui appartint jadis à son chanteur préféré. Soudain, les ténèbres s’illuminent, les feuilles scintillantes virevoltent autour du petit garçon et l’emportent… au royaume des morts.
Rassurons-nous, Coco n’est pas un remake des Noces funèbres de Tim Burton. C’est bien plutôt un film sur l’amour de la famille, sur la mémoire des proches disparus depuis plus ou moins longtemps.

À l’instar des célébrations d’El dia de los muertos, où tout le monde chante et danse, fait la fête et visite les cimetières, la première partie se veut, du moins, a priori, joyeuse et festive. Le royaume des morts que découvre Miguel ne ressemble en rien au Paradis ni à l’Enfer décrits dans les textes religieux et inscrits dans l’imaginaire collectif. C’est une ville gigantesque, peuplée de squelettes et de créatures fantastiques. C’est aussi là que vit Ernesto de la Cruz, décédé il y a des années et que Miguel, pour des raisons qui lui appartiennent, souhaite à tout prix rencontrer.

Alors que ses ancêtres le poursuivent pour le ramener chez lui, Miguel croise la route d’Hector, squelette vagabond à qui personne ne rend hommage en ce jour des morts et qui ne peut, de fait, pas traverser le pont reliant le monde des défunts à celui des vivants pour visiter sa famille. Hector passe donc un marché avec Miguel : il l’aidera à approcher Ernesto de la Cruz en échange de la promesse que dès qu’il aura rejoint le monde des vivants, Miguel ira donner sa photo à sa fille afin que celle-ci continue de se souvenir de lui. Sans cela, Hector disparaîtra à jamais, car plus aucun vivant n’entretiendra sa mémoire.

Ainsi, si les trois premiers quarts d’heure de Coco sont drôles et amusants, le film bascule peu à peu dans une mélancolie frôlant parfois l’élégie, lorsqu’un twist, qu’on ne révèlera pas, vient bouleverser les certitudes et le destin des personnages.
C’est là que l’on retrouve tout le génie de la machine à rêves Pixar : cette habilité à mélanger les registres, à entretenir une forme d’ambiguïté quant au niveau de lecture de ses œuvres. Est-ce drôle ou triste ? Faut-il rire ou pleurer ? Les deux à la fois, sans doute, comme en témoigne le dénouement particulièrement émouvant de Coco.

Les réalisateurs Lee Unkrich et Adrian Molina ont su créer un univers vivant et coloré, où le royaume des morts est aussi accueillant que celui des vivants ; les animateurs s’en donnent à cœur joie, s’amusant à monter, désosser et remonter les squelettes, avec la fluidité et la précision d’un horloger, exploitant la plasticité et les nombreuses possibilités de construction et de reproduction du mouvement. L’art de l’animation en images de synthèse atteint une nouvelle fois son apogée.
En outre, et bien que le projet de Pixar soit bien antérieur à la dernière élection présidentielle américaine, l’idée de camper l’intrigue de Coco au Mexique constitue la meilleure réponse à la folie conservatrice et anti-mexicaine de Donald Trump. Peut-être Coco deviendra-t-il, malgré lui, un film profondément politique et polémique (dans le bon sens du terme).

Fort d’une puissance imaginaire et féérique absolument formidable, véritable hymne à la famille, à l’enfance, à la mémoire et à l’amour, Coco est à coup sûr un chef-d’œuvre qui confirme une nouvelle fois la place de Pixar parmi les studios maîtres du cinéma d’animation.

Le premier plan de Coco prend quelque peu de court, de la part d’une production Pixar. Une paire de mains âgées surgit dans le cadre en gros plan, affairée à des rites aux allures funèbres. Le titre du film surgit à son tour, et la voix off du héros commence sa narration sur fond de guirlandes de papier animées.

C’est la voix d’un petit garçon, donc les mains ne lui appartenaient pas – on trouvera plus loin qu’elles pourraient être celles de sa grand-mère. Il est rare qu’un film Pixar semble nous faire entrer aussi directement et frontalement dans l’action, voire au contact avec son sujet.

C’est une frontalité apparente qui interpelle, et rend d’autant plus attentif à la suite ; même si, paradoxalement, celle-ci s’avère un peu moins surprenante et moins intimiste, cette ouverture laisse entendre un rapport plus fragile du film à sa matière, empreint d’une certaine urgence de se rapprocher du cœur de celle-ci.

Investissant cette fois pour décor le folklore musical et funéraire mexicain, la maison Pixar revisite de nouveau le thème dont elle a fait son principal terreau et fonds de commerce : le rapport au souvenir, son culte, son regret voire sa réinvention.

Derrière sa prémisse classique de conflit entre aspiration individuelle et héritage (le petit Miguel, rejeton d’une dynastie de cordonniers, fait le désespoir de sa famille en s’obstinant à vouloir devenir musicien), l’enjeu du récit de Coco revient à la reconstitution d’une mémoire collective meurtrie (collective, sachant qu’à un niveau individuel elle n’existe que dans l’imagination de l’enfant).

Cela consiste à ramener une branche déchue de l’arbre généalogique, celui-ci figuré par les photos en arborescence dans l’oratoire familial – la branche manquante étant au sommet, la photo déchirée d’un ancêtre voué aux gémonies – et musicien, justement – dont l’identité et le visage restent mystérieux.

La célébration du Día de los Muertos, ce jour de l’année où vivants et défunts se rapprochent, offre à l’enfant l’occasion d’aller chercher de quoi combler ce manque au seul endroit où cela semble encore possible : l’au-delà, refuge de ceux qui ne peuvent plus exister que dans les souvenirs – à moins qu’on ne les oublie définitivement.

Or, et ce pourrait être une spécificité de Coco parmi les films Pixar, cette quête de la mémoire est compliquée – et plus seulement motivée – par l’intervention de l’autre donnée qui alimente cette filmographie : la mythologie (celle qui sert de décor à chaque nouveau film).

Ou plus exactement les mythologies, les imaginaires : celui qu’a adopté le personnage (il présume que son idole musicale, un mariachi super-star, est aussi son mystérieux aïeul), mais aussi l’imaginaire mexicain sur le monde des morts, incarné à grands frais par le savoir-faire numérique (population de squelettes, cité gigantesque, créatures fantastiques…).

Vivent les morts !
Ainsi tout le film est-il articulé autour de la rencontre conflictuelle entre ces deux vues de l’esprit, entre leurs représentations, leur visibilité. Dans le monde vivant, l’imaginaire de Miguel tient dans son petit refuge sous les combles d’une maison, aménagé en oratoire rempli de disques de son idole autour de la petite télé diffusant ses prestations ; il n’existe que dans ces traces du passé.

L’autre monde, lui, est une incarnation concrète et imposante d’un imaginaire collectif passé par l’industrie Pixar : les couleurs y sont plus vives, les espaces plus grands, même les écrans – ceux où le chanteur idolâtré par Miguel, et narcissique jusque dans la mort, reproduit lui-même son image passée et présente – plus larges. Tout y est si démonstratif (comme l’envers de ce qui est implicite du point de vue des vivants) que même l’oubli d’un défunt y est représenté visuellement, par sa dissolution dans l’espace.

Ce que le film synthétise et orchestre ainsi tient alors du paradoxe, celui de son happy-end : de cette rencontre des illusions doit découler le surgissement d’un souvenir, un vrai – mais aussi la réunion des vivants et des morts dans le visible, soit un « Jour des morts » représenté en prenant pleinement parti pour ce que l’imagerie populaire en imagine.

Le processus pour y parvenir peut paraître imposant, avançant parfois au pas de charge avec une linéarité un peu décevante, mais cela rend encore plus prégnant l’apaisement que constitue le dénouement de réconciliation. On pourra toujours repenser, non sans une certaine nostalgie, à l’époque des premiers films où Pixar – pas encore « Disney•Pixar » – faisait montre d’un peu plus de grâce dans son savoir-faire, et où le fond de son imaginaire n’était pas encore un fonds de commerce.

Mais, à l’aune du premier plan de Coco et de ce que le film atteint au bout d’un parcours semé d’embûches, on pourra constater que la firme, derrière son métier de belle machine bien rodée, reste capable de toucher authentiquement au cœur.

10/10



![[Sortie Blu-ray/DVD] Les Seigneurs de Harlem de Bill Duke](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/04/les_seigneurs_de_harlem-100x75.webp)





















![[Sortie Blu-ray/DVD] Les Seigneurs de Harlem de Bill Duke](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/04/les_seigneurs_de_harlem-300x194.webp)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Sous le Tapis de Camille Japy](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/03/64b801e732909_cinema-100x75.jpg)