AU REVOIR LA-HAUT
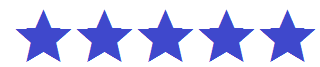
Avec un travail pictural qui renvoie au cinéma des années 20, Albert Dupontel livre un brûlot anticapitaliste qui pourrait tout aussi bien avoir lieu de nos jours. L’effervescence d’après-guerre n’en reste pas moins le théâtre d’un mélodrame poignant et magistralement reconstitué.
![au-revoir-la-haut-affiche[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut-affiche1.jpg)
Réalisation : Albert Dupontel
Scénario : Albert Dupontel, Pierre Lemaître
d’après : le roman Au revoir là-haut
de : Pierre Lemaître
Interprétation : Nahuel Pérez Biscayart (Édouard Péricourt), Albert Dupontel (Albert Maillard), Laurent Lafitte (Pradelle), Niels Arestrup (Marcel Péricourt), Émilie Dequenne (Madeleine Péricourt), Mélanie Thierry (Pauline), Héloïse Balster (Louise), Philippe Uchan (Labourdin), André Marcon (l’officier gendarme), Michel Vuillermoz (Joseph Merlin)
Créatrice des masques : Cécile Kretschmar
Distributeur : Gaumont
Date de sortie : 25 octobre 2017
Durée : 1h57
![au_revoir_la-haut[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au_revoir_la-haut1.jpg)
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des Années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..
Même si ses précédents films faisaient toujours joliment leur effet, on pouvait commencer à craindre qu’Albert Dupontel ne commence à se répéter. Son adaptation du best-seller de Pierre Lemaitre vient heureusement nous prouver que l’ancien humoriste est capable de nous livrer autre chose que les comédies chargées en humour noir qui ont fait son succès. Basé sur une reconstitution des années 1918-20, son long-métrage ne s’éloigne pourtant pas entièrement de son sujet de prédilection qu’est la souffrance des marginaux. En effet, ses deux personnages principaux sont deux vétérans de la Grande Guerre inaptes à reprendre le cours de leur ancienne vie au sein de la société civile.
![au-revoir-la-haut.20170906033239[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut.201709060332391.jpg)
La première qualité de sa réalisation est assurément le soin apporté à la direction artistique pour recréer cette période historique effervescente. Qu’il s’agisse des uniformes portés par les poilus dans les tranchées ou des tenues élégantes de la bourgeoisie parisienne, chaque costume est une pure réussite. Il en est de même pour les décors, même si la mise en scène ne les met pas forcément en valeur. Sur un plan formel, la véritable prouesse est à chercher du côté pictural, en particulier le travail sur le grain et la colorimétrie qui donnent l’impression que les images, pourtant tournées en numérique, datent d’il y a un siècle.
![au-revoir-la-haut-photo-slider[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut-photo-slider1.jpg)
La mise en scène s’identifie par de longs et amples mouvements de caméra, permettant une certaine immersion au cœur de cette reconstitution. Celle-ci fait particulièrement son effet dans la partie du film se déroulant dans les tranchées. Certes court, ce segment en devient l’une des peintures les plus impressionnantes qu’il nous ait été récemment permis de voir de la Première Guerre mondiale. Le retour des deux personnages principaux à Paris s’accompagne cependant d’une réalisation plus apaisée. Cette peinture des « Années folles » paraît presque quelque peu académique, au moins par rapport à l’esprit « rock’n roll » que ce que nous avait vendu la bande-annonce qui, dans un montage frénétique, se concentrait sur une scène de fête que Dupontel filme à la façon de Terry Gilliam, son modèle assumé depuis ses débuts. La folie, l’hystérie et la décadence, de l’après-guerre se retrouvent sacrifiées à l’autel du pamphlet anticapitaliste, ce qui aurait en soi pu se situer à n’importe quelle autre période du XXe siècle.
![Au-revoir-la-haut-un-film-politique-et-poetique-tres-fort[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/Au-revoir-la-haut-un-film-politique-et-poetique-tres-fort1.png)
En terme d’adaptation, Dupontel est resté relativement fidèle au roman de Lemaitre, en en édulcorant les aspects les plus rocambolesques pour se concentrer sur le drame humain vécu par les deux personnages principaux, interprétés par Nahuel Perez Biscayart et lui-même. Le premier n’est autre que la révélation du récent phénomène 120 battements par minute ; un doublé qui devrait lui permettre, sinon de décrocher un César fort mérité, de s’assurer une carrière florissante. Dupontel, en revanche, livre une prestation moins éblouissante car dans un rôle assez proche de ce qu’on a l’habitude de le voir jouer, celui d’un être fragile qui va devoir se faire violence pour exister.
![au-revoir-la-haut-photo-laurent-lafitte-niels-arestrup-997421[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut-photo-laurent-lafitte-niels-arestrup-9974211.png)
Comme à son habitude, l’une des forces du scénario de Dupontel est le soin apporté aux personnages secondaires, et l’excellent casting sollicité à l’occasion aide à hisser Au revoir là-haut au panthéon des films français les plus saisissants de la décennie. Parmi les acteurs qui permettent un tel rayonnement, Laurent Laffite en figure maléfique, incarnation d’une classe dirigeante uniquement animée par le besoin viscéral d’humilier les faibles, prouve qu’il est décidément bien plus pertinent dans la peau de telles ordures que dans celle d’individus auxquelles il nous est demandé de nous identifier. Niels Arestrup est brillant dans la façon qu’il a de faire de son personnage, a priori lui aussi détestable, mais aussi le plus poignant de cette histoire. De leur côté, Philippe Uchan ainsi que, dans une moindre mesure, Michel Vuillermoz, apportent au film sa part d’humour, dans laquelle on retrouve l’esprit grinçant du réalisateur.
![Au-Revoir-La-Haut-Film-15-1024x423[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/Au-Revoir-La-Haut-Film-15-1024x4231.png)
L’une des meilleures surprises de ce casting vient du rôle octroyé à Emilie Dequenne, un personnage certes accessoire à l’intrigue centrale mais qui parvient à se libérer de son statut de potiche pour prouver, non sans cynisme, que la cruauté intéressée au sein de la bourgeoisie n’est pas affaire de sexe. La dénonciation sociétale brutale est donc tout aussi intemporelle que la poésie qui se dégage de ce récit à fleur de peau. L’ensemble forme un magnifique film que n’aurait pas désavoué Jean Renoir tant il fait appel à une façon de faire des films aux antipodes de ce que nous assène régulièrement le cinéma français, depuis trop longtemps adepte des codes de la télévision et de la publicité. Il semble que, vingt ans après l’électrochoc Bernie, Albert Dupontel ait compris qu’il fallait en passer par un certain classicisme pour secouer une industrie hexagonale quelque peu moribonde. Espérons que, malgré les imperfections de son long-métrage, le public lui donnera raison sur ce point.
![au-revoir-la-haut-bandeau[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut-bandeau1.jpg)
L’ANALYSE :
Après 9 mois ferme, Au revoir là-haut confirme qu’Albert Dupontel cinéaste tend à laisser derrière lui ses atours surfaits de pourfendeur punk (Bernie, Le Créateur) pour viser un artisanat plus proche du mainstream. Les grimaces de sale gosse de ses personnages se sont assagies, et sa mise en scène, hier en quête frénétique d’effet « in your face », s’est mue en un savoir-faire plus conventionnel de mouvements d’appareils toujours très expressifs mais au moins dirigés vers des sujets, balayant le soupçon d’un opérateur se regardant opérer, ne gardant de l’ancienne agitation de trublion que le meilleur : une évidente envie de filmer (un sujet, des personnages) et non de bouger machinalement sa caméra.
![au-revoir-la-haut-5[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut-51.jpg)
Albert, moins méchant ? Sans doute, néanmoins on distingue encore çà et là de discrètes traces de cruauté : ici un raccord sur de la viande qu’on hache dans un hôpital où l’on soigne des mutilés de guerre, là un raccord sonore entre un corps défenestré qui s’écrase et une porte qui s’ouvre avec fracas. Mais cela semble aussi une manière pour le cinéaste d’éloigner encore un peu plus le spectre de l’amidonnage académique qui, comme sur tout film français touchant au patrimoine national (ici la Première Guerre mondiale et les « Années folles »), plane sur son film picaresque tâchant de flirter avec divers genres, notamment en glanant une poignée de visions d’horreur et en instillant une atmosphère à la lisière du cauchemar.
![au-revoir-la-haut-3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut-31.jpg)
Adaptation du roman homonyme de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut suit le parcours de deux anciens poilus (dont l’un est si défiguré qu’il préfère passer pour mort) tâchant de survivre ensemble par la combine dans le Paris des années 1920. C’est à la suite de ce tandem singulier que le film suit une double piste, romanesque d’un côté, forain de l’autre. Dupontel joue celui des deux qui peut encore se montrer ; à sa charge donc d’entreprendre des démarches aux yeux de tous, d’aller à la rencontre de la société et de ses intrigues – rencontrant notamment, à la faveur de détours scénaristiques opportuns, des personnages craints du passé des deux hommes.
![au-revoir-la-haut-1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut-11.jpg)
L’autre héros, auquel l’excellent Nahuel Pérez Biscayart prête surtout ses yeux et sa gestuelle (sa voix est réduite à des borborygmes), s’est reclus dans l’ombre où il s’adonne à l’exhibition des masques ingénieux qu’il s’est fabriqués, et à l’échafaudage d’une combine audacieuse et sans scrupule (une arnaque aux monuments aux morts) aux dépens de la société qu’il rejette. Avec son apparence fantasmagorique et ses réactions humaines dont l’expression est rendue fruste par le handicap, le personnage ressemble à un de ces monstres sur lesquels Guillermo Del Toro reporte toute son affection, en particulier le faune du Labyrinthe de Pan (comme celui-ci, il a pour public préféré une petite fille) – une réminiscence guère surprenante chez Dupontel qui a déjà invoqué dans plusieurs de ses films un autre « visionnaire » forain, Terry Gilliam.
![au-revoir-la-haut-2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut-21.jpg)
D’une certaine façon, le film de Dupontel est tenu par cette confrontation entre deux destinées possibles, pour les héros et pour lui-même : entre un personnage qui veut montrer son appartenance au monde en allant chercher les péripéties du scénario, et un autre qui se drape de sa singularité et de sa monstruosité fabriquée au fond de son antre où il peut inspirer émerveillement et malaise. À l’arrivée, c’est le scénario et ses détours romanesques qui ont raison du monstre, en le faisant vaincre par ses sentiments, achevant au passage de diluer la promesse de subversion offerte par l’arnaque à la commémoration, sur laquelle le film s’est entre-temps fendu de quelques traits satiriques récréatifs.
![au-revoir-la-haut[2]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut2.jpg)
On n’en sera pas si amer : on aura suivi sans déplaisir ces démonstrations contradictoires, d’autant plus que le surmoi de « Créateur » de Dupontel s’est assez calmé pour laisser exprimer sa réelle affection pour ses personnages, jusqu’aux pires salauds, même ceux qui le seront devenus (voir la saisissante dernière sortie du personnage joué par Émilie Dequenne).
![au-revoir-la-haut[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut1.jpg)
9/10
![Kimi de Steven Soderbergh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Kimi-affiche-300x194.jpeg)
![When Evil Lurks de Demián Rugna [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/When-Evil-Lurks-affiche-100x75.jpg)
![Black Flies de Jean-Stéphane Sauvaire [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Black-Flies-affiche2-100x75.jpg)
![Le deuxième Acte de Quentin Dupieux [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Le-deuxieme-acte-affiche-100x75.jpg)
![Eat the Night de Caroline Poggi et Jonathan Vinel [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Eat-the-Night-affiche-100x75.jpg)


![Time Cut de Hannah Macpherson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Time-Cut-affiche-100x75.jpg)
![[Sortie Blu-ray/DVD] La Zone d’intérêt d Jonathan Glazer, réalité recomposée](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/240201-la-zone-d-interet-de-jonathan-glazer-le-sang-je-ne-veux-pas-le-voir-2-100x75.jpg)



![Fallout : Du jeu au petit écran que vaut l’adaptation du jeu vidéo ? [Dossier série]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/07/Fallout-affiche-100x75.jpg)




![Time Cut de Hannah Macpherson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Time-Cut-affiche-300x194.jpg)


![Une Femme en Jeu d’Anna Kendrick [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/10/Une-Femme-en-Jeu-affiche-100x75.jpg)
![L’Intrusion d’Adam Salky [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/08/l-intrusion-film-affiche-100x75.png)
![Jeu Intérieur de Greg Jardin [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/10/Jeu-interieur-affiche-100x75.jpg)
![Rebel Ridge de Jeremy Saulnier [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/09/Rebel-Ridge-affiche-100x75.jpg)
![Uglies de McG [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/09/Uglies-film-affiche-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Ricardo et La Peinture de Barbet Schroeder](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/10/0182483.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx-100x75.jpg)
![Call of Silence de Vardan Tozija [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/08/Call-of-Silence-Vardan-Tozija_lecoindescritiqauescine1-100x75.jpg)
![[Sortie Blu-ray/DVD] Hiruko The Goblin de Shinya Tsukamoto](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/08/Hiruko3-100x75.webp)


![[Sortie Blu-ray/DVD] Un Silence de Joachim Lafosse](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/07/un-silence-daniel-auteuil-100x75.webp)
![[Sortie Blu-ray/DVD] Notre Corps de Claire Simon](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/05/59ee187_1695723770787-notre-corps02-100x75.jpg)




















![au-revoir-la-haut-affiche[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/10/au-revoir-la-haut-affiche1.jpg)
![Kimi de Steven Soderbergh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Kimi-affiche-238x178.jpeg)

![When Evil Lurks de Demián Rugna [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/When-Evil-Lurks-affiche-238x178.jpg)
![Kimi de Steven Soderbergh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Kimi-affiche-100x75.jpeg)
