A MOST VIOLENT YEAR
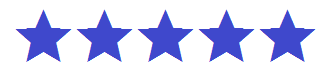

- Réalisation : J.C. Chandor
- Scénario : J.C. Chandor
- Image : Bradford Young
- Décors : John P. Goldsmith
- Costumes : Kasia Walicka-Maimone
- Son : Steve Boeddeker
- Montage : Ron Patane
- Musique : Alex Ebert
- Producteur(s) : Neal Dodson, Anna Gerb, J.C. Chandor
- Production : Before The Door, Washington Square Films, Old Bull Pictures
- Interprétation : Oscar Isaac (Abel Morales), Jessica Chastain (Anna Morales), David Oyelowo (Lawrence), Albert Brooks (Andrew Walsh)
- Date de sortie : 31 décembre 2014
- Durée : 2h05

A Most Violent Year est le troisième long-métrage de J.C. Chandor, un plutôt jeune réalisateur (41 ans tout de même) qui fait officiellement, avec ce film, son entrée dans la cour des grands.
L’histoire en bref
A Most Violent Year se déroule pendant l’hiver 1981 à New York. Abel Morales (formidable Oscar Isaac) est un chef d’entreprise hispanique (mexicain me semble-t-il) dans la vente de fioul. Malgré ses origines modestes, il a réussi à gravir les échelons et à racheter l’entreprise dans laquelle il n’était que chauffeur au début des années 1970. Il épouse même la fille de l’ancien patron, ce qui, reconnaissons-le, complète le tableau idyllique du rêve américain qu’il semble vivre. Mais la situation est beaucoup plus contrastée qu’il n’en paraît.

Tout d’abord, depuis plusieurs mois, ses camions sont régulièrement attaqués et volés par des gangsters qui lui dérobent sa marchandise. Ses soupçons se portent sur ses concurrents directs. En effet, le milieu du pétrole new-yorkais s’avère pour le moins corrompu et offre une belle galerie de portraits à la Martin Scorsese.

D’ailleurs, le rendez-vous au sommet entre tous les patrons des entreprises, dans l’arrière salle d’un restaurant new-yorkais, est un hommage magnifique à Goodfellas (Les Affranchis en version française, mais j’ai toujours eu du mal avec cette traduction, certes juste, mais qui fait très franchouillarde) ou à Casino.

Sauf que justement J.C. Chandor connaît aussi bien que nous les codes du cinéma de genre et s’amuse à les triturer. Dans cette scène où la tension est palpable, la catharsis aurait dû se matérialiser, dans un premier temps par un échange de punchlines bien senties, puis dans un deuxième temps par une explosion de violence inouï.

Car, on le sait bien, dans un film de gangster, rien ne se résout par le dialogue dans un restaurant (même Michael Corleone l’a appris à ses dépens dans Le Parrain de Francis Ford Coppola : voir la scène finale du restaurant). J.C. Chandor décide de faire prendre une autre voie à son personnage principal qui n’est pas une grande gueule, ni un homme violent (nous y reviendrons plus tard).

Ensuite, son entreprise était dirigée par un personnage peu recommandable aux méthodes expéditives. Son beau-père (puisqu’il s’agit de lui si vous avez bien suivi…) est un truant repenti, qui n’hésite pas à donner des conseils très limites : ne s’embarrassant pas de questions métaphysiques pour régler les conflits, il lui propose avec insistance d’armer tous ses chauffeurs afin d’en finir pour de bon.

En résumé, il préfère frapper et en finir avec cette histoire qui a duré trop longtemps, plutôt que parlementer. Les chiens ne faisant pas des chats, sa fille, Anna Morales, interprétée par la décidément très douée Jessica Chastain, partage le point de vue de son père et souhaiterait que son mari soit un peu plus intransigeant. Même si elle semble indéniablement chercher à évoluer sur le plan social, on comprend entre les lignes qu’elle regrette les méthodes de son père.

En parallèle, nous suivons le destin chaotique d’un des chauffeurs d’Abel Morales, Louis Servidio (joué par le surprenant Christopher Abbott, un acteur à l’incroyable talent d’interprétation), lui aussi jeune immigré hispanique souhaitant, comme son patron, gravir les marches du succès.

Le parallèle entre ces deux personnages à l’histoire comparable mais aux destins totalement croisés est une réussite éblouissante et souligne à la fois le talent narratif de J.C. Chandor et surtout son ambition formelle.

Abel Morales se prendra d’une sympathie sincère pour ce jeune homme et tentera à plusieurs reprises de l’aider. Ce sera sans compter la malchance et une certain dose d’incompréhension entre les deux hommes qui fera basculer le destin du jeune chauffeur.

Il est d’ailleurs assez impressionnant de constater à quel point le fond et la forme prennent corps de façon poignante à certains moments clés de l’histoire pour se rejoindre dans une fin, certes attendue, mais d’une maîtrise technique et conceptuelle peu communes ces derniers temps.

L’histoire se déroulant sous nos yeux ébahis telle une tragédie, dont le point final aura des échos sociologiques et politiques ouvrant la voie à des interprétations qui pourront ravir les meilleurs « polémistes » de notre temps.

Qualités :
Mise en scène / Histoire et enjeux / Profondeur des personnages / Références du réalisateur
Défauts :
On a beau chercher…

Le tombeau des illusions
Abel Morales est un personnage intéressant à plus d’un titre. Tout d’abord, évoquons son rapport à la violence. Il n’est pas à l’aise avec cette dernière. Une anecdote (qui n’est pas vraiment un spoiler, je vous rassure) éclaire cet état de fait : un soir, en rentrant en voiture avec sa femme, il percute un cerf. Ce dernier est encore en vie et agonise sur le bas côté de la route. Sa femme lui demande avec insistance de l’achever pour abréger ses souffrances, ce qui est compréhensible et plutôt humain. Mais Abel n’y parvient pas.

Pire encore, il décide d’utiliser, me semble-t-il, le cric de la voiture pour accomplir sa tâche. Ce moment, assez pathétique, où l’on voit Abel se tenir à côté du cerf agonisant avec son cric à la main pendant plusieurs longues secondes illustre à merveille son incapacité à utiliser la violence, même pour une « bonne cause ». Il faudra attendre que sa femme arrive à son secours en tirant une balle dans la tête à l’animal avec un sang froid et un aplomb qui contrebalance avec son manque d’initiative.

Ce moment clé sera le point de bascule du film. Abel est désormais à découvert : il ne peut, tout simplement, pas faire preuve de violence et tout son argumentaire sur ses méthodes de travail et sa volonté d’agir en transparence pour éviter les problèmes avec la justice ne tiennent plus la route. Au contraire, sa femme, Anna, s’affirme et met un peu plus la pression sur son mari qui semble de plus en plus ne pas pouvoir agir, à défaut d’avoir une réelle stratégie pour résoudre ses problèmes avec les gangsters.

A MOST VIOLENT YEAR ET LES FILMS DE GENRE
Mais est-ce réellement le cas ? Le film est plus complexe qu’il n’en paraît. En effet, Abel pourrait n’être qu’un lâche si nous étions dans un film de gangster classique. Le film est d’ailleurs structuré comme un film de genre, il y a tous les ingrédients qui en découlent : la scène de restaurant dont nous avons déjà parlé, les scènes avec les prêteurs sur gage juifs (un grand classique des films de gangsters hollywoodiens, voir Le Prêteur sur Gage de Sydney Lumet, même si le sujet diffère un peu)…

…la scène de poursuite en voiture ouvertement inspirée de The French Connection de William Friedkin (l’un des plus grands réalisateurs américains vivants, doit-on le rappeler), la scène d’introduction où Abel fait son footing sur une chanson de Marvin Gaye (Inner City Blues pour les connaisseurs) rappelant Serpico de Sydney Lumet (l’un des plus grands réalisateurs américains morts, doit-on le rappeler)…

Mais, le film est loin d’être un film de genre classique. Et ce n’est pas anodin si j’évoque cette scène de footing matinale pour finir. Quand, dans Serpico cette scène ne sert qu’à illustrer le fait que Frank Serpico est cool – branché – ou tout ce que vous voudrez, dans A Most Violent Year, la musique choisie n’est pas anodine : il s’agit d’une chanson du début des années 1970, très marquée par la filmographie de Scorsese.

Abel a sans doute grandi en baignant dans cette ambiance de violence exacerbée dont les films de Scorseseen sont les illustrations artistiques. Le film se déroule en 1981, or deux ans plus tard sort Scarface de Brian de Palma qui demeure le summum des films de gangsters pour tous les immigrés américains, à fortiori hispaniques.

SOCIOLOGIE ET POUVOIR
Rappelons que New York en 1981 c’est : 200 000 personnes accros à l’héroïnes, le crack faisant également son apparition à cette époque, la police est totalement corrompue et déconsidérée (rappelons que Serpico est une histoire vraie), une tension ethnique et sociale cause de nombreuses révoltes (pour rappel, à ceux qui suivent l’actualité et en particulier les discours inconséquents de Fox News, il y a de vraies « no-go-zones » à l’époque) et surtout, en 1981 on compte près de 2000 meurtres rien que dans la ville de New York, ce qui sera un record jusqu’au début des années 1990 (on atteindra 2245 en 1990 et cela conduira les autorités à mettre en place une politique de répression sans précédent, appelée la politique « zéro tolérance »).

Cette société violente et parlant constamment de violence est remarquablement dépeinte dans A Most Violent Year. À plusieurs reprises, les personnages écoutent la radio et il n’en sort qu’une longue litanies de crimes et délits en tous genres : viols, meurtres atroces, accidents…

Ces scènes rappellent certaines séquences de Massacre à la Tronçonneuse, le chef d’oeuvre dérangeant de Tobe Hooper, dans lesquelles le réalisateur décrit une société totalement rongée et obsédée par la violence en confrontant ses personnages avec un flot incessant d’extraits de flashs radios énumérant des crimes en tous genres. Le tout dépeignant une société malade autant effrayée par la violence qu’attirée de façon inconsciente par celle-ci.

Or, Abel ne semble pas touché par ce goût pour la violence. Et ce n’est pas uniquement parce qu’il est peureux. En fait, la violence ne l’intéresse pas. Abel est un pragmatique, il est avant tout un chef d’entreprise qui veut développer ses affaires. Et son analyse en la matière est souvent excellente : il ne perçoit pas en quoi l’utilisation de la violence pourrait avoir du sens dans son univers, tant personnel que professionnel.

C’est un acte rationnel qui, à plusieurs moments du film, lui paraît évident. Il a beau le rappeler à son entourage, cela ne fait pas mouche : sa femme le prend pour un lâche, son beau-père et même son avocat réclament plus de « sévérité ». Ce dernier allant même jusqu’à lui rappeler que lui-même est un « bandit » quand Abel se moque de sa proposition d’aller faire un tour dehors pour parler (là aussi, J.C. Chandor joue avec les codes du film de genre).

Abel a beau être cerné de toutes parts, il a un projet et le garde en tête. Point d’idéalisme dans son comportement, tout ce qu’il sait (et en cela il anticipe ce que vont devenir les années 1980 et surtout les années 1990) c’est que la violence n’est pas une bonne chose pour ses affaires et elle n’engendrerait qu’une escalade d’événements qui conduiraient à sa perte.

En effet, s’il décide d’armer ses chauffeurs, alors l’un d’entre eux finira par tuer un truant, ce qui l’amènera devant le juge et l’empêchera d’obtenir des prêts bancaires. La spirale de l’échec étant sans fin cela finirait par faire couler sa boîte.

C’est en se fixant cette ligne de conduite claire qu’il construira son succès et que tout son entourage finira par l’accepter en tant que chef d’entreprise et, non pas, en tant que chef de clan, chose qu’il rejettera jusqu’au bout. Cela lui ouvrira, par la même occasion, la voie du succès, dans cette Amérique qui est en train de changer (pour le pire et le meilleur), dans laquelle les gangsters d’autrefois sont peu à peu remplacés par des entrepreneurs gérant leur business de manière moins radicale sur le plan de la violence.

Bien sûr, Abel n’est pas vertueux et son goût du respect de la loi est à géométrie variable. Il ne veut pas user de la violence car il n’a rien à en tirer. Par contre, il ferme les yeux sur d’autres pratiques, tout aussi répréhensibles, mais moins voyantes : les financements occultes, l’argent noir, les détournements de biens sociaux…

En cela, lorsqu’il s’aperçoit que sa femme est sortie des clous pendant plusieurs années, il ferme volontairement les yeux et se tourne vers un futur radieux puisque, désormais, le monde sourit aux chefs d’entreprise et pourchasse les gangsters, personnages ridicules issus d’un autre temps.

“The whole film is about playing against that escalation [NDLR : l’escalade de violence], and not so much for any ethical or moral reason, but because it’s mainly pragmatic. He just does not see that it makes sense from either a business or personal or anything else. It does not make sense to him as a rational act.”
J.C. Chandor

Abel et Caïn
Évidemment, Abel est un prénom hautement symbolique. Dans l’Ancien Testament, Abel est le premier humain à mourrir et, surtout, il est le premier homme victime d’un meurtre.

Pour rappel, Abel et Caïn sont les deux fils d’Adam et Ève. Caïn, l’aîné, cultive la terre et Abel (de l’hébreu souffle, vapeur, existence précaire) garde le troupeau. Le premier offre à Dieu des fruits de la terre, le second des premiers-nés de son troupeau de moutons. Dieu apprécie Abel et son offrande, mais non pas celle de Caïn. Jaloux, Caïn finit par tuer son frère.

Pourquoi cette analogie ? Abel Morales n’est pas une victime, mais il est mal entouré. Il croit dominer son destin or, celui-ci se joue de lui à plusieurs reprises (je n’évoquerai pas ici les rebondissements du scénario, il faut bien garder un peu de mystère…).

Mais l’analogie s’arrête ici. Abel Morales est arrogant, il est sûr de son bon droit, il sait qu’il a du talent. Cependant, il ne peut pas réussir seul et n’accepte que difficilement cet état de fait. J.C. Chandor sait avec talent comment illustrer son propos : il dépeint avec minutie Abel s’habillant avec soin, en se regardant dans le miroir. Celui-ci porte des vêtements de « nouveaux riches », or son petit frère est encore dans une université quelconque à jouer au football américain pour payer ses études.

Pourtant, Abel n’hésite pas à lui demander une signature pour lui céder ses parts d’un appartement qu’il doit mettre en hypothèque. Il semble tout contrôler, mais ce n’est qu’une illusion et heureusement sa femme veille sur ses affaires depuis des années.

Abel est un personnage réussi car il n’est pas parfait. Il a des valeurs, il a de la bonne volonté, il souhaite sincèrement aider ses chauffeurs et ne les prend pas de haut. Pourtant, il leur fait courir des risques inconsidérés, à cause de ses méthodes, certes innovantes et vouées à la réussite.

Par ailleurs, il envoie de jeunes commerciaux au « casse-pipe » ,au sens propre comme au sens figuré, sans prendre la mesure de la situation. Enfin, il ne peut que constater, lors d’un des derniers plans (sublime) du film, son fioul couler en même temps que le sang des victimes de sa réussite flamboyante.

En arrière-plan, la skyline de New York est toujours présente, tel un rappel permanent de la raison pour laquelle il se bat.

D’abord floue derrière les épaules d’Abel, la skyline devient nette et somptueuse, dans le dernier tiers du film, à mesure que l’entrepreneur parvient à entrevoir de façon de plus en plus nette le succès qui semble lui ouvrir un futur à la mesure de son ambition débordante.

ANALYSE
New York – 1981. L’année la plus violente qu’ait connu la ville. Le destin d’un immigré qui tente de se faire une place dans le business du pétrole. Son ambition se heurte à la corruption, la violence galopante et à la dépravation de l’époque qui menacent de détruire tout ce que lui et sa famille ont construit.
A most violent year… et sa ribambelle de nominations, parmi lesquelles les Oscars et les Golden Globes. Et alors ? Oui, la mise en scène sert le propos, par ses larges plans fixes qui instaurent avec brio une certaine pesanteur. Oui, les acteurs sont bons, si ce n’est excellents. On ne présente plus Jessica Chastain, cette belle Rousse qui, dans le film, trompe sa couleur d’origine autant que son époux, interprété par Oscar Isaac.

L’acteur, moins connu, trouve ici un rôle à la hauteur de son talent et de son charisme.
Enfin, ne parlons pas si vite de « beau rôle » puisque son personnage dévie de l’exemplarité à l’escroquerie, rongé par l’ambition et un ego disproportionné. Autrement dit, le propre des gangsters. Et c’est bien là, dans ce basculement du bien vers le mal, que repose tout l’intérêt du film.
On pourrait même qualifier A most violent year de film « interne » tant le réalisateur, J.C. Chandor, s’échine à montrer l’invisible, les déchirements de la conscience, le combat intérieur qui fait rage à travers un être humain ordinaire ou presque, lorsqu’il est en proie au pouvoir. Il y parvient sans mal à travers une galerie de personnages secondaires efficaces, aussi domptés par la peur que son anti-héros.

Et, par contraste au calme apparent de Abel, en toile de fond, l’essor de la manne pétrolière, au début des années 1980. Soit la mise en abîme de la place prépondérante de l’argent et des difficultés financières dans un secteur devenu extrêmement concurrentiel, quitte à y laisser sa peau et, par extension, dans un monde en crise et en pleine mutation.
Se reflètent alors dans les quais de ce canal tant désiré de magnifiques cadrages, dont le plan d’ouverture, entre chien et loup, et le plan final, enneigé, qui annonce la fragilité de l’ordre rétabli. Il n’y a aucun doute, J.C. Chandor sait instaurer une atmosphère poisseuse et glaciale mais le film s’achève sur une étrange sensation de survol. Ou peut-être une déception, liée à la renonciation du protagoniste et à l’implacable réalité quand, parfois, la fin justifie les moyens.
19/20
![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-300x194.png)
![Super Charlie de Jon Holmberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Super-Charlie-affiche2-100x75.png)
![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-100x75.jpg)

![The Brutalist de Brady Corbet [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Brutalist-affiche-100x75.jpg)
![Red Bird de Alexandre Laugier, Thomas Habibes et Houssam Adili [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Red-Bird-affiche-100x75.jpg)
![Greenland : Migration de Ric Roman Waugh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Greenland-Migration-affiche-100x75.jpg)

![PRIMATE de Johannes Roberts [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Primate-affiche-100x75.jpg)









![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-300x194.jpg)

![Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés de Rian Johnson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Wake-Uo-Dead-man-affiche-100x75.jpg)
![Troll 2 de Roar Uthaug [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Troll2-affiche-100x75.jpg)
![Jay Kelly de Noah Baumbach [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Jay-Kelly-affiche-100x75.jpg)
![Train Dreams de Clint Bentley [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Train-Dreams-affiche-100x75.jpg)
![Le Fils de Mille Hommes de Daniel Rezende [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Le-fils-de-mille-hommes-affiches-100x75.jpg)
![Frankenstein de Guillermo Del Toro [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Frankenstein-affiche-100x75.jpg)

![Carol de Todd Haynes [édition limitée]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Carol-01-100x75.png)
![Eddington d’Ari Aster [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Eddington-affiche-100x75.jpg)

![Thunderbolts* de Jake Schreier [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/09/Thunderbolts-affiche-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Dahomey de Mati Diop](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/06/1695-100x75.jpg)
![Here de Robert Zemeckis [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/03/Here-affiche-100x75.jpg)
![Die Alone de Lowell Dean [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/02/Die-Alone-affiche-100x75.jpg)





![Until Dawn: La mort sans fin de David F. Sandberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/05/Until-Dawn-affiche-100x75.jpg)

![Minecraft, le film de Jared Hess [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/04/Minecraft-Affiche-100x75.png)
















![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-238x178.png)

![Super Charlie de Jon Holmberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Super-Charlie-affiche2-238x178.png)
![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-100x75.png)
