LAURENCE ANYWAYS
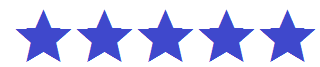
Une fresque émouvante et intime sur les chassés-croisés d’un couple en pleine mutation. Laurence Anyways : Variation transgenre sur la fatalité du couple!
![laurence_anyways-3-6dcb3[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence_anyways-3-6dcb31.jpg?w=740)
Réalisation : Xavier Dolan
Scénario : Xavier Dolan
Image : Yves Bélanger
Montage : Xavier Dolan
Musique : Noia
Producteur(s) : Carole Mondello, Lyse Lafontaine, Nathanaël Karmitz, Charles Gillibert
Interprétation : Melvil Poupaud (Laurence Alia), Suzanne Clément (Fred Belair), Nathalie Baye (Julienne Alia), Monia Chokri (Stéfanie Belair)…
Date de sortie : 18 juillet 2012
Durée : 2h39
![031-laurence-anyways-theredlist[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/031-laurence-anyways-theredlist1.png?w=740)
Difficile d’imaginer que Xavier Dolan a 23 ans lorsqu’il écrit et réalise LAURENCE ANYWAYS, une fresque amoureuse et intime retraçant une histoire d’amour sur une décennie, dont le format d’envergure (2H48) révèle un film d’une immense maturité et d’une intensité bouleversante. Bien sur, ce quatrième long métrage possède quelques irrégularités scénaristiques et redondances stylistiques, mais pour autant il se dégage de ce film une force éblouissante. Xavier Dolan sonde une fois de plus l’âme humaine et nous raconte l’histoire d’un homme qu’il choisit d’appeler Laurence et d’une femme, Fred, dont l’amour inébranlable se heurte à un choix intime. Xavier Dolan a vu grand et il insuffle à sa mise en scène ainsi qu’a sa direction d’acteurs, une poésie exacerbée entre une écriture très précise et quelques envolées improvisés qui octroie au film une véritable intensité.
![035-laurence-anyways-theredlist[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/035-laurence-anyways-theredlist1.jpg?w=740)
D’ailleurs Suzanne Clément obtient pour le rôle de Fred le prix d’interprétation féminine dans la catégorie Un certain Regard à Cannes. Dans LAURENCE ANYWAYS, Dolan se révèle incroyablement sensible et saisit avec grâce et empathie l’essence de la difficulté de vivre ou d’aimer et la transforme en une œuvre cinématographique lyrique et poétique… Magnifique.
![1118full-laurence-anyways-photo[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/1118full-laurence-anyways-photo1.jpg?w=740)
Laurence Alia est professeur de philosophie mais aussi poète, il est d’ailleurs en pleine écriture d’un recueil qu’il espère publier. Le soir de ses 35 ans, il avoue à Fred avec qui il partage une complicité sans faille et un amour passionnel, qu’il veut devenir une femme pour espérer être enfin heureux. Par amour, Fred accepte de l’accompagner dans cette transformation envers et contre tous (surtout elle même) mais quel en sera le prix ?
![1118full-laurence-anyways-screenshot[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/1118full-laurence-anyways-screenshot1.jpg?w=740)
C’est par le prisme de la poésie que Xavier Dolan réalise LAURENCE ANYWAYS qu’il dote d’un lyrisme et d’une volubilité qui existent en tout premier lieu dans les images. Dés l’ouverture nous découvrons Laurence dans une ambiance vaporeuse marchant à travers une fumée opaque. On distingue la silhouette d’une femme mais la camera qui flirt avec son visage ne nous le dévoile jamais, nous ne saurons que quelques séquences plus tard qu’il s’agissait d’un transexuel.
![4454cf4c6080dad8ba60a4645a4cf45a[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/4454cf4c6080dad8ba60a4645a4cf45a1.jpg?w=740)
Et c’est dans cette imagerie toute fantasmagorique au stylisme des années 90 que Dolan met en scène son film. Il crée des tableaux allégoriques qui viennent ponctuer le déroulement de l’histoire pour exprimer une émotions pure. Ainsi il filme en plan fixe Fred sur un lit au centre du cadre recevant sur la tête un déluge d’eau ou Laurence laissant sortir de sa bouche béante un papillon qui prend son envol.
![26196_Laurence_Anyways_-_copyright_Shayne_Laverdi___re[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/26196_laurence_anyways_-_copyright_shayne_laverdi___re1.jpg?w=740)
Mais son idéal poétique ne s’arrête pas là, le réalisateur y consacre des séquences entières. Il orchestre des pluies diluviennes qui s’abattent sur des paysages témoins d’un émoi (pluie de vêtements aux couleurs criardes dans une neige blanche immaculée ou de feuille d’automnes rougies et soulevées par le vent à la sortie d’un bar). Au delà de la beauté indéniable de la photographie, c’est la haute valeur symbolique de ces plans qui propulse le film dans une dimension esthétique véritablement majestueuse.
![e2730b1e2e0d94d5c340f6e6e7f712e1[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/e2730b1e2e0d94d5c340f6e6e7f712e11.jpg?w=740)
Et si, comme à son habitude, Xavier Dolan livre un film à la direction artistique précise dont il maîtrise les influences, toujours parfaitement exécutées (entre ses emprunts à l’Elephant de Gus van Sant pour les déambulations de Laurence dans les couloirs du lycée en travelling de dos, Wong Kar-Wai pour les néons rouges dans les rues de la ville sous la pluie battante, les plans filmés au fond du couloir de Stanley Kubrick et une référence à David Lynch pour ses visages freaky), il peine cette fois à maîtriser son scénario.
![IMG_8343[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/img_83431.jpg?w=740)
”Dolan nous parle de survie, Dolan nous parle d’amour, Dolan nous parle de la blessure de l’existence. Dolan ébloui par sa lucidité et sa finesse d’analyse. (…) La beauté sensible de LAURENCE ANYWAYS est fascinante.”
![Lauren2ce-Anyways[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/lauren2ce-anyways1.jpg?w=740)
LAURENCE ANYWAYS est un film qui se mérite puisqu’il trouve son envol et toute son intensité à la fin de la première heure. En effet, le début du film souffre d’une exposition mal canalisée qui traîne en longueur et ne convainc pas tout à fait. Xavier Dolan s’attache à construire exagérément et sans véritable envie l’histoire d’amour qu’il va déconstruire par la suite, et enferme ses personnages dans des scènes de dialogues illustratifs – entre petites phrases , tics verbaux et redondances d’expressions, dont on doute de la nécessité et du réel bénéfice. On frôle souvent le décrochage mais une fois le climax atteint, la mise en scène se libère, la parole se fait plus dense et nécessaire. Xavier Dolan peut enfin faire ce qui lui plait et s’engouffre avec maestria dans son thème de prédilection: les douleurs de l’âme et de l’amour. A la beauté des images et à la bande son exceptionnelle (Moderat, The Cure , Visage, Depeche mode…) vient alors se juxtaposer l’histoire puissante et déchirante qui peinait a exister.
![laurence anyways 4[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-anyways-41.png?w=740)
Car LAURENCE ANYWAYS est un récit intime émouvant qui n’a rien du plaidoyer sur le transgenisme auquel on pourrait penser. Il s’agit d’une ode à la liberté et au courage d’être soi envers et contre tous. Laurence se heurte au regard du monde, des habitants de la ville, de ses élèves et de son entourage mais en fait son chemin de croix. D’ailleurs Dolan nous offre des séquences de regards-camera en travelling ralenti intenses où il nous projette littéralement dans la peau de Laurence qu’on dévisage et dont nous ressentons alors le malaise, entre gène et audace. Cette question du regard d’autrui très Sartrienne dont Laurence enseigne la philosophie est centrale.
![laurence_anyways_Melvil_Poupaud_01[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence_anyways_melvil_poupaud_011.jpg?w=740)
Tout au long de sa transformation, Laurence pose les jalons de sa nouvelle identité et de sa nouvelle vie à travers le regard des autres qu’il sonde continuellement. En tout premier lieu, il interroge le regard amoureux de Fred et celui de sa mère dont il sollicite la bénédiction, puis il extirpe toute la considération humaine et éthique qu’il réclame du regard fuyant de la journaliste qui l’interviewe. Laurence trouvera son apaisement définitif au hasard du clin d’œil séducteur qu’un jeune homme pense alors adresser à une (vraie) femme…
![Laurence_Anyways_pic_01_3[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence_anyways_pic_01_31.jpg?w=740)
Si LAURENCE ANYWAYS évoque le dessein d’un homme, Xavier Dolan embrasse plus largement la question du destin des autres, de ceux qui restent. Le premier rôle n’est pas celui qu’on croit, il est partagé entre trois entités. La réelle déchirure que Dolan vient mettre en scène est avant tout celle d’une femme, Fred, qui perd l’homme qu’elle aime et celle d’une histoire d’amour passionnelle qui, malgré la bataille que chacun mène pour la sauver, est devenue impossible.
![laurence_anyways_ver3_xxlg-3630[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence_anyways_ver3_xxlg-36301.jpg?w=740)
Durant les dix ans que restitue Xavier Dolan, Fred et Laurence chercheront sans cesse à se retrouver, se fondre inéluctablement l’un dans l’autre comme dans le mythe d’Aristophane, mais chacune de ces retrouvailles sera le théâtre d’un nouveau déchirement. Leurs vies respectives toujours plus lointaines les ont indéniablement séparés sans jamais pourtant parvenir à les faire renoncer à leur amour. Xavier Dolan qui avait eu tant de mal à construire et installer une complicité dans les premières séquences la fait maintenant exploser.
![laurence7[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence71.jpg?w=740)
Les dialogues préfabriqués se sont mués en effusions hystériques et passionnelles, entre improvisation brutale et réquisitoire poignant sur la difficulté d’aimer. Il y a par instant un lâcher prise inattendu dans la mise en scène (plan de dispute en shaky cam bien loin des cadres hyper composés et chiadés qui jalonnent le film) et dans la direction des comédiens qui touche à quelque chose de l’ordre de la Vérité. Suzanne Clément livre d’ailleurs une performance puissante et écorchée magistrale.
![tumblr_mjx0vaoQ7Q1s5657io7_1280[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/tumblr_mjx0vaoq7q1s5657io7_12801.jpg?w=740)
Xavier Dolan retrouve dès lors le verbiage excessif de J’AI TUE MA MÈRE et vient flirter avec notre identification éventuelle. Le récit s’intensifie , la tension se crée et l’émotion nous assiège, on y croit enfin. Alors que Laurence demande à Fred si elle l’aime encore lors de retrouvailles secrètes, le dos tourné, elle lâche dans un cris de désarroi et de culpabilité « J’taime plus que mon fils (…)Mais tu crois que je vais hypothéquer ma vie pour que tu puisses faire la tienne ? » et lorsqu’il lui demande ce qu’elle « veut », elle lui répond avec une gifle « Un homme ! je veux un homme Laurence ! »
![tumblr_mjx0vaoQ7Q1s5657io5_1280[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/tumblr_mjx0vaoq7q1s5657io5_12801.jpg?w=740)
LAURENCE ANYWAYS est finalement une fois de plus dans la filmographie de Xavier Dolan une métaphore de la confession. D’ailleurs le film s’ouvre sur un noir avec pour seule information la bande son et une discussion qui semble être une séance de psychanalyse. Une histoire racontée qui chapitrera le film jusqu’au dernier plan ou il se révélera être l’interview de Laurence Alia, femme transgenre poétesse dont nous aurons suivi le cheminement. La boucle est bouclée dans une belle prouesse narrative.
LAURENCE ANYWAYS est une histoire d’amour, une histoire humaine, mais Dolan s’est attaché à y dresser le portrait des âmes féminines en devenir, en conquête ou en reconquête de soi qui, peu importe le prix à payer (celui du bonheur amoureux), ne renonceront jamais à vivre selon leurs inspirations profondes. Dolan nous parle de survie, Dolan nous parle d’amour, Dolan nous parle de la blessure de l’existence. Dolan ébloui par sa lucidité et sa finesse d’analyse. Alors que Laurence doit devenir une femme pour survivre, Fred doit perdre Laurence pour se pas sombrer, sans jamais cesser de l’aimer… La beauté sensible de LAURENCE ANYWAYS est fascinante .
![rOYsV3yjbef5uN7iIL7WinteF1a[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/roysv3yjbef5un7iil7wintef1a1.jpg?w=740)
Pour aller plus loin : Les deux premiers films de Xavier Dolan avaient posé les balises de son cinéma; Laurence Anyways essaie de les surpasser. En manipulant les mêmes objets cinématographiques, les mêmes outils, mais en augmentant leur portée, dans la durée et dans l’ambition; voilà un film qui raconte une histoire qui n’arrive pas à se limiter, qui refuse en quelque sorte la simplicité; bien sûr, il n’y a rien de simple à raconter sur dix ans la vie d’un homme qui décide de changer de sexe… mais au fond, oui. Au fond, Anyways, c’est juste un film d’amour.
![Lawrence-Anyways-2-e1347980473974[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/lawrence-anyways-2-e13479804739741.jpg?w=740)
On comprend bien que l’histoire d’un homme qui, à 35 ans, à l’aube des années 90, décide de devenir une femme, au péril de sa relation avec sa conjointe Fred, n’est pas simple, n’est pas une histoire comme les autres. La vie de couple n’est plus la même, la vie de famille non plus, et il en va de même pour la vie professionnelle. Et pourtant, il est tout à fait logique qu’au cinéma comme dans la société (il faudrait le réexpliquer à certains, mais c’est un autre débat) les histoires d’amour ne soient plus exclusivement réservées à un homme et à une femme.
![Laurencе_Anyways[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurencd0b5_anyways1.png?w=740)
Ce sont les déclinaisons de l’amour qu’on retrouvait déjà chez Dolan, et chez Honoré. Et chez Almodovar, tant qu’à y être. À nouveau, même dans ce contexte inhabituel, Dolan propose une succession d’images et de sons qui visent à créer un affect, une émotion sans justification rationnelle. C’est donc l’amalgame des possibilités du cinéma (la musique est ici – comme toujours – parfaitement intégrée à l’histoire) qui crée tour à tour des scènes, parfois de simples fragments d’images, des sons, des émotions d’une étrange beauté, dont l’impact est photographo-épileptique – une fraction de seconde – et inexplicable. Il y en a des centaines pendant les 165 minutes de Laurence Anyways. L’instinct de Dolan pour les images fortes est toujours présent; son audace, sa témérité, son assurance, tout y est. Mais tout, c’est parfois trop.
![Laurence-Anyways-Suzanne-Clement[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-anyways-suzanne-clement1.jpg?w=740)
Car bien sûr, toutes ces tentatives ne fonctionnent pas également. Cela doit différer d’une personne à l’autre, d’un vécu à l’autre. Mais on capte immanquablement quelques-uns de ces moments, comme c’était le cas dans Les amours imaginaires et dans J’ai tué ma mère. Une scène au lave-auto au son de Prokofiev s’avère tout particulièrement épique, un paroxysme de musique et d’images de cinéma. Il y en a d’autres, mais ils se découvrent mieux dans un contexte contrôlé comme une bonne salle de cinéma.
![laurence-anyways-liberte[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-anyways-liberte1.jpg?w=740&h=462)
C’est aussi l’occasion de découvrir l’interprétation inspirée de Melvin Poupaud dans le rôle de Laurence, l’énergie de Suzanne Clément, la galerie colorée de personnages secondaires et d’apprécier les pointes d’humour et les clins d’oeil que Dolan fait à toutes ces choses qu’on a dites et écrites sur lui depuis son arrivée intempérante dans la sphère du cinéma.
![Laurence-Anyways-Facebook-Copyright-Lyla-Films-[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-anyways-facebook-copyright-lyla-films-1.jpg?w=740)
C’est dommage que Laurence Anyways soit trop long, parce que s’il ne l’était pas, on pourrait parler d’autre chose, de toutes ses qualités et de ses quelques défauts. On devrait parler d’autre chose, en fait, mais Laurence Anyways est vraiment trop long. Les grands moments sont ainsi dispersés entre quelques scènes parfois redondantes, parfois simplement mal jouées, qui allongent inutilement une simple histoire d’amour. Pas comme les autres, on veut bien, mais elles le sont toutes. Ce n’est pas leur unicité qui rend belles les histoires d’amour, c’est leur beauté, tout simplement.
![laurence-anyways-2012-xavier-dolan-13[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-anyways-2012-xavier-dolan-131.png?w=740)
Pour aller encore plus loin : Avec Laurence Anyways, le jeune réalisateur québécois Xavier Dolan risque de surprendre ceux qui avaient vu ses deux premiers films (J’ai tué ma mère et Les Amours imaginaires). Laurence Anyways est selon nous son meilleur. Tout ce qu’il y avait de bluette légère et jeune laisse ici place à une gravité insoupçonnée et met ainsi en lumière ce qui est peut-être la figure matricielle essentielle du récit dolanien : le ressassement, le retour du même, la spirale.
![Laurence-Anyways-2[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-anyways-21.jpg?w=740)
Laurence Anyways, avec ses deux heures trente-neuf, ne fait que répéter les mêmes aveux, les mêmes retrouvailles, les mêmes douleurs sous des formes différentes. C’est bien de variations sur un thème qu’il est question : comment deux êtres ne cessent de se rencontrer et d’essayer en vain de vivre leur amour, quand l’obstacle à cet amour semble insurmontable à l’un des deux : le sexe (au sens physique du terme) de l’autre ?
Laurence (Melvil Poupaud), professeur de littérature, et Fred (Suzanne Clément) s’aiment et vivent ensemble. Le jour de son trentième anniversaire, Laurence confie à Fred qu’il s’est toujours senti femme et qu’il ne voit pas comment il pourrait être heureux dans la peau d’un homme.
![laurence-anyways[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-anyways1.png?w=740)
Le choc est terrible pour Fred. Laurence est au désespoir. Ils se séparent.
Alors qu’il commence la longue métamorphose médicale et chirurgicale, les années vont passer et les deux amoureux malheureux se recroiser à plusieurs reprises. Laurence devient un écrivain célèbre. Chaque scène de retrouvailles est l’occasion de nouveaux déchirements et pourtant jamais la lassitude n’envahit le spectateur. Pourquoi ?
Parce que tout ce qui demeurait à l’état d’artifices dans les premiers films de Xavier Dolan semble ici trouver sa raison d’être. Sa propension à transformer des scènes en clips (ou le contraire), sur la piste de Wong Kar-wai, devient ici, dans le contexte d’un drame amoureux, comme un récitatif d’opéra.
![laurence-anyw5ays[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-anyw5ays1.jpg?w=740)
Son goût pour les couleurs vives donne à la moindre scène une stylisation voulue et souhaitable : du glamour à l’hollywoodienne. Ses excès de jeunesse, sa mégalomanie, trouvent ici un sens, dans son obstination à vouloir malgré tout réunir deux êtres humains qui ne peuvent s’unir. La durée du film elle-même, qui trahit sa volonté de réaliser une grande fresque, trouve sa justification dans ce ressassement intime obligé d’un impossible amour.
![laurence-a4nyways[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-a4nyways1.jpg?w=740)
![laurence7[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence71.jpg?w=740)
Au fond, Dolan renoue avec un certain cinéma, celui de cette période hollywoodienne un peu incertaine du début des années 70, prise entre la fin du classicisme et le début de la modernité, où un réalisateur comme Sydney Pollack tentait de trouver une nouvelle voie en pratiquant un cinéma de stars un peu dévoyé : Laurence Anyways descend directement de Nos plus belles années, que Pollack réalisa en 1973 avec Barbra Streisand et Robert Redford, longue histoire de retrouvailles entre deux jeunes étudiants que tout (la classe sociale, les goûts, les idées politiques) séparait.
![Laurence_Anyways_pic_01_3[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence_anyways_pic_01_31.jpg?w=740)
Dolan redonne à ce genre plutôt mineur un regain de juvénilité et de modernité. Melvil Poupaud, dans son plus grand rôle, prend une dimension insoupçonnée en abandonnant ceux de jeunes hommes qui ont fait son succès ; Suzanne Clément est remarquable en petite-bourgeoise quand même assez coincée ; Nathalie Baye se montre encore meilleure que d’habitude dans un de ces personnages de mère puissante et un peu effrayante dans lesquels elle a toujours excellé – notamment dans Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg).
L’ANALYSE :
Le cinéma québécois, entité qui effarouche les cinéphiles par son goût emphatique du sujet de société, n’a jamais trouvé en France, hormis quelques succès occasionnels, une attention digne du lien qui nous relie à nos seuls vrais cousins d’Amérique. Depuis peu, un jeune énergumène nommé Xavier Dolan a réduit d’un coup en miettes cette prévention.
![laurence anyways 4[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-anyways-41.png?w=740)
Enervée et provocatrice, intelligente et malséante, forte de l’effervescence de la jeunesse, son oeuvre, d’emblée mise en valeur par le Festival de Cannes, a aussitôt été repérée comme un phénomène à suivre. Il faut dire que le trajet est impressionnant. Premier long-métrage à 20 ans, d’inspiration ouvertement autobiographique, sur la relation conflictuelle et fielleuse entre un adolescent homosexuel et sa mère (J’ai tué ma mère, 2009). Le film divise mais fait beaucoup parler de lui. La promesse est rapidement suivie d’une confirmation, celle des Amours imaginaires (2010), sorte de Jules et Jim de notre temps, pop, métrosexuel et enlevé.
![Laurencе_Anyways[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurencd0b5_anyways1.png?w=740)
Avec Laurence Anyways, Dolan présente son projet à ce jour le plus ambitieux. Une histoire de passion amoureuse déchirée dont l’action, qui dépasse les deux heures trente, se déroule sur une dizaine d’années, de la fin des années 1980 à l’aube du XXIe siècle. La belle affaire, dira-t-on, après Ingmar Bergman et Jean Eustache.
![1118full-laurence-anyways-photo[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/1118full-laurence-anyways-photo1.jpg?w=740)
Précisons : il y a bien une femme et un homme qui s’aiment, mais l’homme, un beau matin, veut devenir une femme. Problème. Lucidement formulé par la femme, effondrée, lorsque son partenaire lui avoue sa décision : « Tout ce que j’aime de toi, c’est ce que tu détestes de toi. » Mais l’altérité transgenre n’est ici que le cache-sexe, pour ainsi dire, d’une problématique plus classique : la capacité d’un couple, qui se veut naïvement sans limites, à surmonter ce qui borne son désir. Le motif de la transsexualité devient ainsi une sorte de figuration littérale de la définition lacanienne de l’amour : donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas.
![1118full-laurence-anyways-screenshot[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/1118full-laurence-anyways-screenshot1.jpg?w=740)
Le film qui en ressort est un monstre déconcertant. D’un côté, la fuite baroque, le goût du kitsch, le scintillement de l’esthétique queer, la dramaturgie court-circuitée en même temps qu’intensifiée par un flot musical omniprésent (de The Funeral Party de The Cure jusqu’à la « Cinquième » de Ludwig Van Beethoven). De l’autre, un bon vieux mélo des familles, qui ne déroge pas aux canons : primat du romanesque, exposition limpide du conflit, respect du déroulement narratif, dialogues ciselés, morceaux de bravoure pathétiques. Tout démarre en 1989, par l’évocation d’un jeune couple branché qui tire de son aisance à défier les convenances le carburant d’une passion dévorante. Fred (Suzanne Clément), tempérament de feu, est scripte dans le milieu du cinéma, Laurence (Melvil Poupaud), funambule mélancolique, enseignant en littérature à l’université. Les deux personnages portent, du moins au Québec, un prénom mixte, à l’unisson d’une époque qui lâche du lest sur la définition bio-sociale des rôles et des genres.
![tumblr_mjx0vaoQ7Q1s5657io7_1280[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/tumblr_mjx0vaoq7q1s5657io7_12801.jpg?w=740)
C’est de là, logiquement, que vient la faille. Une chose est de cultiver le brouillage des identités, y compris sexuelles, une autre de vouloir en changer. Confronté à cet ultime tabou, qui vaut à Laurence son exclusion sociale, le couple est mis à l’épreuve. Laurence, honnête vis-à-vis de son désir, se transforme en femme mais pense que tout est encore possible entre eux. Fred, à laquelle est imposée cette métamorphose, veut croire qu’elle s’en accommodera mais présume de son propre désir. Le mouvement du film prend dès lors la forme tragique d’un impossible amour, d’une élégie qui prolonge sur dix années de ruptures et de retours l’agonie d’une passion vouée à un destin fantomatique.
![laurence-anyw5ays[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-anyw5ays1.jpg?w=740)
A côté de personnages secondaires particulièrement bien campés (Nathalie Baye parfaite en mère détruite de Laurence, Monia Chokri électrisante en soeur lesbienne qui dispute à Fred le monopole de l’altérité familiale), les deux rôles principaux jouent une partition contrastée. Abattage maximal, un rien épuisant, pour Suzanne Clément, détermination tout en finesse et retenue pour Melvil Poupaud. Si l’acteur français y gagne, à n’en pas douter, le plus beau rôle de sa carrière, le film y perd en revanche une part de sa puissance. La sérénité et le minimalisme du jeu de Poupaud, destinés à naturaliser son personnage dans le cadre d’une peinture d’un couple de notre temps, ont en même temps pour effet d’étouffer le trouble et la complexité de la différence qu’il revendique. Laurence demeure, aux yeux du spectateur, un garçon charmant qui se déguise en fille, sans que rien du vertige intérieur qui détermine cette mutation ne semble affecter sa relation au sexe, à l’amour ni au monde.
![Lawrence-Anyways-2-e1347980473974[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/lawrence-anyways-2-e13479804739741.jpg?w=740)
Quelques films récents – on pense notamment à Tiresia (2003) de Bertrand Bonello, Wild Side (2004) de Sébastien Lifshitz, ou Mourir comme un homme (2009) de Joao Pedro Rodrigues – ont apporté sur le sujet une profondeur, une ambiguïté et une sensualité autrement plus déstabilisantes.
![Laurence-Anyways-Facebook-Copyright-Lyla-Films-[1]](https://cinemaccroblog.files.wordpress.com/2017/10/laurence-anyways-facebook-copyright-lyla-films-1.jpg?w=740)
Il y a sans doute, de la part de Xavier Dolan, une certaine naïveté à réduire ainsi le personnage de Laurence au rôle de fer de lance d’une campagne contre la normativité sociale. Du moins, ce romantisme juvénile, associé à la grâce pimpante de sa mise en scène, offrent-ils une raison très valable d’apprécier le film et d’espérer en la maturité d’un auteur qui va aussi vite en besogne.
9,5/10
![Kimi de Steven Soderbergh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Kimi-affiche-300x194.jpeg)
![When Evil Lurks de Demián Rugna [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/When-Evil-Lurks-affiche-100x75.jpg)
![Black Flies de Jean-Stéphane Sauvaire [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Black-Flies-affiche2-100x75.jpg)
![Le deuxième Acte de Quentin Dupieux [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Le-deuxieme-acte-affiche-100x75.jpg)
![Eat the Night de Caroline Poggi et Jonathan Vinel [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Eat-the-Night-affiche-100x75.jpg)


![Time Cut de Hannah Macpherson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Time-Cut-affiche-100x75.jpg)
![[Sortie Blu-ray/DVD] La Zone d’intérêt d Jonathan Glazer, réalité recomposée](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/240201-la-zone-d-interet-de-jonathan-glazer-le-sang-je-ne-veux-pas-le-voir-2-100x75.jpg)



![Fallout : Du jeu au petit écran que vaut l’adaptation du jeu vidéo ? [Dossier série]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/07/Fallout-affiche-100x75.jpg)




![Time Cut de Hannah Macpherson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Time-Cut-affiche-300x194.jpg)


![Une Femme en Jeu d’Anna Kendrick [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/10/Une-Femme-en-Jeu-affiche-100x75.jpg)
![L’Intrusion d’Adam Salky [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/08/l-intrusion-film-affiche-100x75.png)
![Jeu Intérieur de Greg Jardin [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/10/Jeu-interieur-affiche-100x75.jpg)
![Rebel Ridge de Jeremy Saulnier [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/09/Rebel-Ridge-affiche-100x75.jpg)
![Uglies de McG [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/09/Uglies-film-affiche-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Ricardo et La Peinture de Barbet Schroeder](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/10/0182483.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx-100x75.jpg)
![Call of Silence de Vardan Tozija [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/08/Call-of-Silence-Vardan-Tozija_lecoindescritiqauescine1-100x75.jpg)
![[Sortie Blu-ray/DVD] Hiruko The Goblin de Shinya Tsukamoto](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/08/Hiruko3-100x75.webp)


![[Sortie Blu-ray/DVD] Un Silence de Joachim Lafosse](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/07/un-silence-daniel-auteuil-100x75.webp)
![[Sortie Blu-ray/DVD] Notre Corps de Claire Simon](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/05/59ee187_1695723770787-notre-corps02-100x75.jpg)





















![Kimi de Steven Soderbergh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Kimi-affiche-238x178.jpeg)

![When Evil Lurks de Demián Rugna [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/When-Evil-Lurks-affiche-238x178.jpg)
![Kimi de Steven Soderbergh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/11/Kimi-affiche-100x75.jpeg)
