![midnight-special-affiche-407e7[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special-affiche-407e71.jpg)
Titre original : Midnight Special
Titre québécois : Le lieu secret
Réalisation et scénario : Jeff Nichols
Direction artistique : Austin Gorg
Décors : Chad Keith
Costumes : Erin Benach
Photographie : Adam Stone
Montage : Julie Monroe
Musique : David Wingo
Production : Sarah Green et Brian Kavanaugh-Jones
Sociétés de production : Faliro House Productions et Tri State Pictures
Société de distribution : Warner Bros. Pictures
Pays d’origine : États-Unis
Langue originale : anglais
Format : couleur – 2.35:1
Genres : Aventure, drame, science-fiction
Durée : 111 minutes
Dates de sortie : 16 mars 2016
Distribution : Michael Shannon, Joel Edgerton, Kirsten Dunst, Adam Driver, Jaeden Lieberher, Sam Shepard


Avec Midnight Special, Jeff Nichols fait le pari risqué, mais réussi, de la montée en gamme. Produit pour la première fois par Warner Bros, pour un budget de 18 M$ (là où Mud n’avait coûté que 10M$ et Take Shelter 5M$), ce thriller fantastique télescope en réalité trois histoires et tonalités : celle, d’abord, d’une chasse à l’homme racée, autour d’un supposé kidnapping d’enfant ; celle, ensuite, d’un enfant aux pouvoirs étranges et convoités, qui semble communiquer avec le ciel ; celle, enfin d’une famille déchirée et impossible à réunir.

Ça démarre à peine et déjà, en sélectionnant sur notre juke-box mental un souvenir d’E.T. qui se superpose à l’introduction du jeune héros de Midnight Special, Jeff Nichols affiche ses intentions. Son quatrième film sera un hommage à l’imaginaire du Spielberg des années 70-80, plus généralement à la SF de l’époque, et même, précise le réalisateur, « aux films de course-poursuite avec le gouvernement comme Starman, Rencontres du troisième type etE.T. l’extraterrestre. » Car on apprend d’emblée qu’Alton est en cavale avec son père Roy après que ce dernier l’a soustrait au Ranch, une secte où les pouvoirs du gamin de 8 ans – son regard laser transmet la prescience d’un « outremonde » – en font une quasi-divinité.
![037230.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/037230.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
Affublé de lunettes de plongée, le fils dévore des comics de Superman à l’arrière de la Chevrolet que Roy et son vieux copain Lucas font tracer dans le noir, vers un lieu, LE lieu, révélé par ses prophéties. Que se passera-t-il là-bas? On ne le saura qu’au terme d’un road-movie à travers une Amérique intemporelle, succession de champs de blé et de stations-service désertes où les cabines téléphoniques – à pièces – se mettent toutes à sonner en même temps. Mythologie automobile face à la puissance occulte d’un territoire monstre, émergence du surnaturel dans une Amérique où la famille nucléaire est le lien perpétuellement défait… Aux motifs spielbergiens s’attachent des citations presque directes, à Rencontres du troisième type surtout, dans lequel un autre Roy roulait aussi, sur les traces d’un lieu pressenti par des visions.
![ht_midnight_special_film_still_mm_160401_16x9_992[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ht_midnight_special_film_still_mm_160401_16x9_9921.jpg)
Midnight Special s’offre même un personnage d’expert dont le nom a une consonance française, Paul Sevier, double du Claude Lacombe jadis interprété par François Truffaut. Mais dans Midnight Special, les échos les plus manifestes ne sonnent pas comme des clins d’œil. À la différence de J.J.Abrams dans Super8, Nichols ne laisse pas le geste mémoriel prendre le pas sur l’actualité de son regard. Ces références il les fond dans la matière du film, dont le cadre et la couleur restituent la sensation 80s avec une grande pureté, sans qu’il y ait besoin d’en rajouter dans le détail fétichiste. Pas d’aplomb postmoderne ni de griserie rétro : cette simplicité dans la manière de rendre hommage réduit paradoxalement la distance où devrait se loger la nostalgie.
![maxresdefault[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/maxresdefault1.jpg)
C’est ainsi que Midnight Special ressemble plus à un film des années 80 qui regarde vers aujourd’hui qu’à un film d’aujourd’hui qui se souviendrait des années 80. Une fable pour ici et maintenant, dont la clé serait prospective. « Alton est plus important », assène Roy à Lucas lorsque son ami hésite à tirer sur qui se met en travers de leur chemin. Plus important que tout, l’enfant n’est pas roi parce qu’il flatte le culte régressif des adulescents grandis sous Reagan, mais parce qu’il est celui qui, demain, emportera l’humanité loin d’un monde subclaquant. Fini les pères fondateurs, lestés par leurs corps trop lourds, place aux fils extraterrestres, de vide et de lumière. Si Midnight Special célèbre à la façon de Spielberg le pouvoir de l’enfance, c’est comme ultime recours quand il ne s’agit plus que de sauver ce qui peut encore l’être. L’âme des enfants d’abord.
![media-title-Midni-30[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/media-title-Midni-301.jpg)
Roy et son fils Alton sont en cavale depuis que le père a appris que son enfant possède des pouvoirs surnaturels. Lucas, un ami de Roy, se joint à l’échappée.
Jamais avant Midnight Special l’intrigue chez Jeff Nichols n’avait paru à ce point resserré, ne se contentant que de porter quelques formes, dans un pur acte de mise en scène. D’un bout à l’autre de son quatrième long métrage, hypnotique, le texan entraîne le spectateur en une fuite noctambule fiévreuse et lapidaire. Là où Shotgun Stories, Take Shelter et Mud se montraient plus diserts quant à la psychologie et la motivation de leurs personnages, Midnight Special ne s’embarrasse d’aucun détail superflu et privilégie l’esquisse d’une structure elliptique jusqu’au-boutiste. La trajectoire, radicale bien que ténue, propulse deux hommes, Roy et Lucas, sur la route à toute allure dans le silence de la nuit.
![media-title-Midni-35[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/media-title-Midni-351.jpg)
Du duo, qui convoie au péril de sa vie Alton, un enfant aux pouvoirs surnaturels vers un lieu énigmatique, l’on ne sait rien ou presque – aucune exposition ne venant nous enquérir des enjeux initiaux. Et d’innombrables questions fatalement taraudent, dans une dynamique quelque peu shyamalanienne. Mais Jeff Nichols ne cloisonne heureusement jamais le regard, l’incitant au contraire à se perdre dans la course effrénée des plans et des séquences. Comme toujours chez lui depuis Take Shelter, toute l’énergie du récit consiste à placer l’enfant au cœur du film, à le sonder et peut-être à terme à le comprendre. C’est que le cinéaste poursuit sa quête introspective, celle d’un homme devenu père et vivant ce nouveau rôle avec beaucoup d’angoisse. Cet être sera-t-il bon, et ses parents capables de dominer leurs peurs afin d’éviter à l’avenir d’exercer sur lui un contrôle néfaste ?
![media-title-Midni-36[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/media-title-Midni-361.jpg)
Toutes ces problématiques a priori terre-à-terre sont précisément ce qui génère la science-fiction dans Midnight Special : l’histoire d’un père et d’une mère contraints de manifester une confiance aveugle en leur enfant, lui-même à l’origine d’évènements extraordinaires. Par-delà les apparences, la question ici posée n’est non pas celle d’un dogme ou d’une croyance, comme le laisse d’abord penser l’importance de la secte d’évangélistes tordus d’où s’enfuit Alton, mais de croire simplement en son enfant. À cet effet, Jeff Nichols projette comme nul autre cette relation intime sur un axe cosmique, comme dans Take Shelter et Mud. Alton, dont l’origine des pouvoirs n’est pas explicite, fonctionne comme une boîte de Pandore, comme un pont entre deux mondes dont l’ouverture inattendue provoque chaque fois son petit cataclysme. Faut-il y voir l’allégorie de l’horizon futur du jeune garçon, perçu par les adultes comme l’imminence d’une possible catastrophe – la fameuse angoisse du père ?
![Midnight Special Movie Set (1)[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Midnight-Special-Movie-Set-11.jpg)
Quoi qu’il en soit, Alton suscite l’intérêt de tous : considéré comme un messie par la secte à ses trousses, il est vu par la NSA comme une arme à même d’interférer sur les communications des services secrets américains. Il serait tentant de connecter tous ces éléments pour y dégager d’autres pistes de réflexion, mais les nombreuses portes laissées entrebâillées par le scénario semblent avant tout une manière pour Jeff Nichols de jouer avec le spectateur, de s’amuser de son intelligence. Sans compter, une fois de plus, une façon de mettre en scène la paranoïa et la lutte contre la société, mantra de son cinéma. Quid de l’absence de technologies dans le film, dont Nichols ne supporte pas la vue : notons à ce titre à quel point le protagoniste de la NSA incarné par Adam Driver est analogique, de sa prise de note à la main à ce moment où il brise symboliquement son téléphone portable.
![Midnight Special Movie Set (2)[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Midnight-Special-Movie-Set-21.jpg)
Comme à son habitude, l’américain développe des atmosphères vaporeuses et quasi oniriques, mais toutefois contaminées par une violence sourde, ou a contrario retentissante – voir la séquence suffocante des satellites s’écrasant près de la station service en des gerbes de flamme. Une dichotomie somme toute plus complexe que les articulations des films de Shyamalan. Le suspense et la tension, avec leurs ressorts mystérieux et leur portée universelle, font plutôt écho dans Midnight Special à Steven Spielberg, à commencer par E.T., Rencontres du troisième type et La guerre des mondes. Analogie qui n’est pas un hasard, lorsque l’on sait combien ces trois films se veulent eux aussi des descriptions délicates de la famille (et de la société) américaine.
![midnightspecial[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight20special1.jpg)
Enfin, il serait logique de ranger Midnight Special aux côtés de métrages eighties dans la veine de Starman (John Carpenter, 1984) qui, non content de partager le mode road movie nocturne sur fond de SF, met aussi en scène un personnage extraordinaire désireux d’atteindre un lieu précis et sibyllin. C’est ainsi que Jeff Nichols introduit l’image de son fils au sein d’un film se revendiquant précisément du cinéma ayant bercé sa propre enfance. Cette époque bénie où les réalisateurs, plutôt que de privilégier comme aujourd’hui les CGI et les rebondissements grandiloquents, s’en remettaient simplement à la famille et à l’affect, sans pour autant en passer par de trop grosses ficelles tire-larmes.

Ce choix d’une œuvre plus que jamais épurée de tout ce qui pourrait permettre au spectateur d’embrasser plus en détails les différents cheminements scénaristiques pourra décontenancer quelques fans de Nichols. En clair, il est probable que les aficionados de ses précédents drames psychologiques restent sur leur faim. Mais si l’on y réfléchit bien, cette dimension d’un long métrage se gardant de tout justifier était présente en filigrane dès Shotgun Stories.

C’est pourquoi Midnight Special ne fait que poursuivre le travail de l’américain, à la différence que ce dernier s’immisce un peu plus qu’à l’accoutumée dans le cinéma de genre (après le film catastrophe, entre autres), archétype de premier ordre pour aborder les tourments de la filiation. La recette partage pour le reste plus d’une similitude avec les précédents métrages de Nichols : Michael Shannon, de nouvelles régions des États-Unis (après l’Arkansas, le Kentucky et le Mississippi, les personnages sillonnent cette fois le Texas, la Louisiane, le Mississippi again, l’Alabama et la Floride), mais aussi un même rapport à la nature, qui exsude même lorsqu’à l’image n’apparaissent que la route et autres zones pavillonnaires – façon Terrence Malick. De cette relecture modeste et lyrique des classiques de la SF des années 80, l’on ressort abasourdi et plus que jamais confiant en la disposition de Nichols à façonner à son gré n’importe quel pan du cinéma américain.

Reste la séquence finale – unique scène où les effets spéciaux sont vraiment visibles à part entière -, qui avec ses faux airs d’Abyss (James Cameron, 1989), risque de diviser. Pas suffisant cependant pour remettre en question la fulgurance et l’intensité de ce quatrième opus, tout entier porté par la puissance de ses formes, entre trouble et fascination.

On aperçoit deux écueils : à droite, l’entrée dans le système et le risque d’une œuvre indépendante désormais surproduite, comme on a pu le voir cette année chez trois réalisateurs rapidement montés, Joachim Trier (Louder than Bombs), Denis Villeneuve (Sicario) et Paolo Sorrentino (Youth) ; à gauche, la tentation d’une mise en scène trop explicite comme celui de M. Night Shyamalan qui ne ménage plus ses effets et perd en subtilité dans la seconde partie des années 2000. Heureusement, ces menaces sont en grande partie écartées. La première, parce que la mise en scène de Nichols reste ancrée dans ses fondamentaux : un territoire qu’il connaît bien, le Texas ; un acteur, Michael Shannon, qui campe à lui seul la radicalité des premiers films ; et enfin une sensibilité toute singulière et une tension atmosphérique sourde.
![midnight_special_wb_2.0[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight_special_wb_2.01.jpg)
La seconde menace, celle de se «shyamalaniser», est plus marquée dans la mesure où la représentation visuelle du fantastique gagne ici en spectacularité. Mais la poésie du film et les enjeux à multiple entrées qui sont développés creusent les images fantastiques d’une pudeur et d’une vraie mélancolie. L’immanence du Texas se ressent d’autant plus qu’il apparaît explicitement, par le champ qu’ouvrent les pouvoirs du jeune garçon la possibilité furtive, et surréelle, d’une transcendance. Un superbe plan paysager, en fin de film, laisse entrevoir la superposition de deux mondes et rend, en contrepoint, l’espace rural texan à sa terrible et pesante vacuité.
![midnight-special_5[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special_51.jpg)
De fait, en passant plus nettement du côté du cinéma fantastique, Nichols creuse un sillon qui était déjà le sien, un certain mysticisme mais qui était alors entremêlé à une attention socio-géographique. Ici, ce passage se fait à l’intérieur même du film. La longue route des personnages accompagne le glissement des tonalités, le kidnapping devient retrouvailles avant de se faire échappée fantastique – il y a dans cet entremêlement quelque chose de Spielberg dans Midnight Special. La conduite du récit, la découverte parcimonieuse des enjeux, le lent déploiement – puis débordement – de la science-fiction, garantissent un mystère salvateur. Le parti pris photographique de travailler une lumière duelle (des couleurs oranges intérieures contre les bleus extérieurs) applique sur les visages la bichromie de l’aube tant redoutées par l’enfant suggère un univers incertain, un malaise irréel.
![midnight-special_10[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special_101.jpg)
Le surnaturel, incarné par un enfant à lunettes de piscine lisant un comic book, surgit par vagues – la première consistant en une spectaculaire pluie de météorites. Si Midnight Special marque tant, c’est parce qu’il situe, comme les précédents films de Nichols, ses personnages sur une lisière dangereuse et instable, entre les mondes, dans une quête inaboutie et mélancolique de leur juste place: Michael Shannon, à la frontière d’une paternité qui lui échappe; pour le jeune Alton, tendu entre sa filiation humaine et son appartenance surhumaine, et, plus encore, au mi temps de l’enfance et de la maturité.
CONCLUSION :
Plongée dans l’Amérique des sectes et de l’occultisme. Un thriller ramassé et haletant d’où émerge une figure bouleversante d’enfant messianique terrorisé par ses pouvoirs.
Certains ont pu croire, dès les premières annonces par Jeff Nichols d’un projet de science-fiction, que le réalisateur de Mud allait changer de planète : changer d’audience, changer de système de production mais aussi changer d’ambition en se frottant pour de bon à une mécanique de grand spectacle qui le trouverait forcément quelque peu transformé. C’était compter sans la façon majestueuse qu’a le très longtemps attendu Midnight Special de perpétuer l’ancrage populaire de Nichols.
![midnight-special-film-fragmani-izle-2016-846[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special-film-fragmani-izle-2016-8461.jpg)
Entre les coutures de l’intrigue fantastique, à l’ombre des déflagrations lumineuses qui explosent dans les yeux du jeune héros, le film reste tapissé de ces communautés sudistes désolées, soudées par la foi, pétries d’instinct clanique et burinées par la poussière, dont le cinéaste ne se séparera vraisemblablement jamais tant elles constituent toujours l’alpha et l’oméga de ses intrigues et la clé de ses obsessions. Aussi loin qu’il pousse ses évasions cosmiques, le cinéma de Nichols demeurera irrigué par la tourbe du Mississippi.
![midnight-special_12[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special_121.jpg)
La foi : il n’a jamais été question que de ça. Autant que les fratries de Shotgun Stories croyaient jusqu’au sang à leur rivalité, comme les héros d’une tragédie grecque, autant que le Curtis de Take Shelter croyait envers et contre tout à l’imminence de l’apocalypse, ici les membres d’un culte vénèrent un enfant dont les pouvoirs ont fait de lui un prophète, à l’existence tenue secrète.
![midnight-special_6[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special_61.jpg)
Alton crache par les yeux une lumière bleue qui révèle à qui la regarde une vérité incommensurable – il est aussi doué d’une quasi-omniscience. Son père (Michael Shannon), sa mère (Kirsten Dunst) et un ami (Joel Edgerton) prennent la fuite avec lui pour une mystérieuse destination, pourchassés par l’armée et par une NSA dont l’agent Sevier (Adam Driver, toujours excellent) fait office de Ponce Pilate.
Or pour la première fois chez Jeff Nichols, les personnages n’ont plus la liberté de ne pas croire. En plongeant pour de bon dans la SF, le cinéaste a offert à la fiction les pleins pouvoirs. Donnée pour argent comptant, la déité de ce garçon connecté à la vérité d’un autre monde n’est plus déséquilibrée par un contrepoint de scepticisme, une indécision de la foi.
![037230.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/037230.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
C’est ce qui fait de Midnight Special un film vraiment déstabilisant : comme si le réalisateur de Take Shelter décidait de littéraliser son écriture du fanatisme au point de ne plus permettre au film d’effleurer l’éveil, la lucidité. Nous sommes avec ceux qui croient, et il faut croire avec eux, ou ne plus croire à la science-fiction, mais qui a envie de ça ? Nichols est joueur, car malgré ce franchissement symbolique il continue de semer ici et là des signes qui viennent compliquer l’équation.
![midnight-special_4[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special_41.jpg)
Le film s’enracine dans l’Amérique des sectes, des cultes millénaristes aux adeptes prêts à mourir et à tuer pour ce qu’ils croient. Pas le temps, pourtant, d’agiter à leur égard la sonnette du charlatanisme : immédiatement en mouvement, Midnight Special est pris dans la cinétique d’un pur chase movie aux relents 80’s (sublime scène où la Chevrolet fuse phares éteints dans la nuit texane, sous la main experte d’un pilote coiffé de lunettes infrarouges), où la vacillation du vrai et du faux reste en hibernation jusqu’à un épilogue qui la voit soudain éclater façon Rencontres du troisième type.

C’est au fond à ça que sert l’odeur insidieusement fanatisée et mystique de Midnight Special : remettre au cœur de la fiction la question de la croyance, en nous transmettant l’expérience d’une foi vis-à-vis de laquelle Take Shelter avait conservé une distance prudente, un nuage d’ambiguïté. Ainsi nous est-il offert de partager la ferveur ingénue de ces personnages auxquels le film révèle les visions naïves d’un monde “au-delà du réel”.
![Midnight Special Movie Set (1)[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Midnight-Special-Movie-Set-11.jpg)
Exemple simple et ravageur : Kirsten Dunst, interdite, contemple un contrechamp dont on taira ici la nature. Et, tandis qu’il se dissipe, son évanouissement portant encore sa trace invisible, Jeff Nichols retourne la caméra et fait d’un champ de blé vide le plus beau plan de ce début d’année.
![18361741_120332000636629455_1425320810_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18361741_120332000636629455_1425320810_n1-2.png)
![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-300x194.png)
![Super Charlie de Jon Holmberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Super-Charlie-affiche2-100x75.png)
![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-100x75.jpg)

![The Brutalist de Brady Corbet [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Brutalist-affiche-100x75.jpg)
![Red Bird de Alexandre Laugier, Thomas Habibes et Houssam Adili [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Red-Bird-affiche-100x75.jpg)
![Greenland : Migration de Ric Roman Waugh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Greenland-Migration-affiche-100x75.jpg)

![PRIMATE de Johannes Roberts [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Primate-affiche-100x75.jpg)









![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-300x194.jpg)

![Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés de Rian Johnson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Wake-Uo-Dead-man-affiche-100x75.jpg)
![Troll 2 de Roar Uthaug [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Troll2-affiche-100x75.jpg)
![Jay Kelly de Noah Baumbach [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Jay-Kelly-affiche-100x75.jpg)
![Train Dreams de Clint Bentley [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Train-Dreams-affiche-100x75.jpg)
![Le Fils de Mille Hommes de Daniel Rezende [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Le-fils-de-mille-hommes-affiches-100x75.jpg)
![Frankenstein de Guillermo Del Toro [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Frankenstein-affiche-100x75.jpg)

![Carol de Todd Haynes [édition limitée]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Carol-01-100x75.png)
![Eddington d’Ari Aster [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Eddington-affiche-100x75.jpg)

![Thunderbolts* de Jake Schreier [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/09/Thunderbolts-affiche-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Dahomey de Mati Diop](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/06/1695-100x75.jpg)
![Here de Robert Zemeckis [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/03/Here-affiche-100x75.jpg)
![Die Alone de Lowell Dean [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/02/Die-Alone-affiche-100x75.jpg)





![Until Dawn: La mort sans fin de David F. Sandberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/05/Until-Dawn-affiche-100x75.jpg)

![Minecraft, le film de Jared Hess [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/04/Minecraft-Affiche-100x75.png)












![spider_man_3-b55bb[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/spider_man_3-b55bb1.jpg)
![spider-man_2-8f926[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/spider-man_2-8f9261.jpg)
![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18337428_120332000609910654_1254544363_n1-4.png)
![446691.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/446691.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![baby_driver_affiches_internationales-2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/baby_driver_affiches_internationales-21.jpg)
![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18337428_120332000609910654_1254544363_n1-1.png)
![002983.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/002983.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![053670.jpg-r_640_360-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/053670.jpg-r_640_360-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![172606.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/172606.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![402103.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/402103.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![446691.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/446691.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![549734.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/549734.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![Ansel-Elgort-in-Baby-Driver[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Ansel-Elgort-in-Baby-Driver1.jpg)
![baby-driver-4[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/baby-driver-41.jpg)
![BabyDriver9[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/BabyDriver91.jpg)
![Baby-Driver-Baby-Waiting-in-Getaway-Subaru[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Baby-Driver-Baby-Waiting-in-Getaway-Subaru1.png)
![BabyDriver[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/BabyDriver1.jpg)
![baby-driver-image-3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/baby-driver-image-31.jpg)
![baby-driver-film[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/baby-driver-film1.jpg)

![baby-driver-review-sxsw-02[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/baby-driver-review-sxsw-021.jpg)
![first-trailer-edgar-wrights-baby-driver[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/first-trailer-edgar-wrights-baby-driver1.jpg)
![MV5BMjE2MjE4Njc1OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjkzNzI2MjI@._V1_SY1000_CR0016351000_AL_[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/MV5BMjE2MjE4Njc1OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjkzNzI2MjI@._V1_SY1000_CR0016351000_AL_1.jpg)
![baby-driver-poster-700x1038[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/baby-driver-poster-700x10381.jpg)
![lovehuntersjaquette-5c987[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/lovehuntersjaquette-5c9871.jpg)
![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18337428_120332000609910654_1254544363_n1-3.png)
![love_5[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/love_51.png)

![ben_3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ben_31.png)
![175171[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/1751711.jpg)
![lovehunters_emmabooth_pavillon[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/lovehunters_emmabooth_pavillon1.jpg)
![lovehunters_stephencurry_fore_et[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/lovehunters_stephencurry_fore_et1.jpg)
![lovehunters_emmabooth_portrait[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/lovehunters_emmabooth_portrait1.jpg)
![lovehunters2-2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/lovehunters2-21.jpg)
![r0_0_729_409_w1200_h678_fmax[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/r0_0_729_409_w1200_h678_fmax1.jpg)
![lovehunters_ashleighcummings_nuit[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/lovehunters_ashleighcummings_nuit1.jpg)
![LOVE-HUNTERS-SM-image-en-avant-790x409[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/LOVE-HUNTERS-SM-image-en-avant-790x4091.jpg)
![the_circle_affiche[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/the_circle_affiche1.jpg)

![18360639_120332000649417132_900260586_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18360639_120332000649417132_900260586_n1.png)
![20161206183156-thecirclemovie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/20161206183156-thecirclemovie1.jpg)
![Emma-Watson-and-Karen-Gillan-in-The-Circle[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Emma-Watson-and-Karen-Gillan-in-The-Circle1.jpg)
![emma-watson-the-circle-movie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/emma-watson-the-circle-movie1.jpg)
![emma-watson-the-circle-movie-image-[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/emma-watson-the-circle-movie-image-1.png)
![emma-watson-the-circle-movie-photos-and-posters-1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/emma-watson-the-circle-movie-photos-and-posters-11.jpg)
![hero_Circle-2017[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/hero_Circle-20171.jpg)
![M_047_Circle_07457R2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/M_047_Circle_07457R21.jpg)
![thecircle-movie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/thecircle-movie1.jpg)
![The-Circle-12[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Circle-121.jpg)
![l_empire_des_sens_4k[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/l_empire_des_sens_4k1.jpg)

![6696_image2_big[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/6696_image2_big1.jpg)
![847306-l-empire-des-sens[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/847306-l-empire-des-sens1.jpg)
![18861348.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18861348.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![18861351.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18861351.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![empire_des_sens_3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/empire_des_sens_31.jpg)
![empire_des_sens003[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/empire_des_sens0031.jpg)
![LEmpire-des-sens[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/LEmpire-des-sens1.jpg)
![ob_f87a10_l-empire-des-sens-portrait-w858[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ob_f87a10_l-empire-des-sens-portrait-w8581.jpg)
![oshima-710x403[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/oshima-710x4031.jpg)
![ppDAQnUrkKm0Q7VtpZhSb4k2qZ8[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ppDAQnUrkKm0Q7VtpZhSb4k2qZ81.jpg)
![rotondes-ferroviaires-film-lempire-des-sens-photo-01[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/rotondes-ferroviaires-film-lempire-des-sens-photo-011.jpg)
![6tkpY2SXnUBwWV4wDTWvvPGe9i6[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/6tkpY2SXnUBwWV4wDTWvvPGe9i61.jpg)
![007726-000-A_1764514-1467724128495[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/007726-000-A_1764514-14677241284951.jpg)
![ob_5aa2f7_realmotsenses-202pyxurz[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ob_5aa2f7_realmotsenses-202pyxurz1.jpg)
![Pourquoi_faut_il_restaurer_L_Empire_des_Sens[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Pourquoi_faut_il_restaurer_L_Empire_des_Sens1.jpg)
![aff_le_laureat-c9cf5[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/aff_le_laureat-c9cf51.jpg)

![alfa-romeo-spider-1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/alfa-romeo-spider-11.jpg)
![laureat-1967-02-g[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/laureat-1967-02-g1.jpg)
![laureat-1967-11-g[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/laureat-1967-11-g1.jpg)
![le_laureat_01[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/le_laureat_011.jpg)
![laureat-1967-17-g[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/laureat-1967-17-g1.jpg)
![le_laureat_02[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/le_laureat_021.jpg)
![le_laureat_03[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/le_laureat_031.jpg)
![le_laureat_04[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/le_laureat_041.jpg)
![le_laureat_05[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/le_laureat_051.jpg)
![the-graduate[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/the-graduate1.jpg)
![The-Graduate-classic-movies-5402638-1024-768[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Graduate-classic-movies-5402638-1024-7681.jpg)
![020-the-graduate-theredlist[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/020-the-graduate-theredlist1.jpg)
![060-the-graduate-theredlist[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/060-the-graduate-theredlist1.jpg)
![song_to_song_aff[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/song_to_song_aff1.jpg)
![18361741_120332000636629455_1425320810_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18361741_120332000636629455_1425320810_n1-1.png)







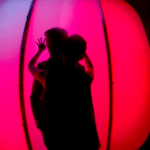








































![001[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/0011.jpg)
![66614_ppl[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/66614_ppl1.jpg)
![every-a-lister-in-hollywood-wants-to-work-with-a-reclusive-director-whos-given-just-one-interview-in-37-years[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/every-a-lister-in-hollywood-wants-to-work-with-a-reclusive-director-whos-given-just-one-interview-in-37-years1.jpg)
![18360378_120332000643230395_1060316420_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18360378_120332000643230395_1060316420_n1.png)
![rooney-mara_songtosong_malick_2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/rooney-mara_songtosong_malick_21-1.jpg)
![screen_shot_2017-02-20_at_1.56.19_pm[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/screen_shot_2017-02-20_at_1.56.19_pm1.png)
![song_to_song.jpg.crop.promoxlarge2.jpg.CROP.promo-xlarge2.jpg.crop.promoxlarge2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/song_to_song.jpg.crop_.promoxlarge2.jpg.CROP_.promo-xlarge2.jpg.crop_.promoxlarge21.jpg)
![song_to_song_portman_fassbender_1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/song_to_song_portman_fassbender_11.jpg)
![Song-to-Song[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Song-to-Song1.jpg)
![song-to-song[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/song-to-song1.png)
![song-to-song_terrence-malick_rooney-mara_02[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/song-to-song_terrence-malick_rooney-mara_021.jpg)
![song-to-song_terrence-malick_rooney-mara_movie_film_2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/song-to-song_terrence-malick_rooney-mara_movie_film_21.jpg)
![Song-to-Song-2-620x259[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Song-to-Song-2-620x2591.jpg)
![Song-to-Song-6[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Song-to-Song-61.jpg)

![Song-to-Song-header-1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Song-to-Song-header-11.png)
![song-to-song-movie-images-fassbender-gosling-mara[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/song-to-song-movie-images-fassbender-gosling-mara1.png)
![song-to-song-movie-images-michael-fassbender-natalie-portman-1075x451[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/song-to-song-movie-images-michael-fassbender-natalie-portman-1075x4511.png)
![song-to-song-movie-images-michael-fassbender-rooney-mara1-1075x454[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/song-to-song-movie-images-michael-fassbender-rooney-mara1-1075x4541.png)
![17SONGSONG1-videoSixteenByNineJumbo1600[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/17SONGSONG1-videoSixteenByNineJumbo16001.jpg)
![RyanGoslingLykkeLi[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/RyanGoslingLykkeLi1-1.png)
![song-to-song-movie-images-terrence-malick[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/song-to-song-movie-images-terrence-malick1-1.png)
![undefined[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/undefined1-1.jpg)
![terrence-malick-song-to-song-ryan-gosling-michael-fassbender-rooney-mara-natalie-portman-456[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/terrence-malick-song-to-song-ryan-gosling-michael-fassbender-rooney-mara-natalie-portman-4561-1.jpg)

![SONG-TO-SONG-NOVO-FILME-TERRENCE-MALLICK-1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/SONG-TO-SONG-NOVO-FILME-TERRENCE-MALLICK-11-1.png)
![Song-to-song-rooney-mara-movie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Song-to-song-rooney-mara-movie1-1.png)
![first-trailer-terrence-malicks-song-to-song[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/first-trailer-terrence-malicks-song-to-song1.jpg)
![loving-affiche[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/loving-affiche1.jpg)
![loving-affiche[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/loving-affiche1.jpg)

![Télécharger-Loving-2016-Film-Complets-1280x640[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Télécharger-Loving-2016-Film-Complets-1280x6401.png)
![04LOVING-master768[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/04LOVING-master7681.jpg)
![Joel-Edgerton-Ruth-Negga-Loving-Movie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Joel-Edgerton-Ruth-Negga-Loving-Movie1.jpg)




![loving-visuel4-2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/loving-visuel4-21.jpg)
![17artsbeat-loving-master768[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/17artsbeat-loving-master7681.jpg)

![ruth-negga-loving-photocall-at-cannes-film-festival-5-16-2016-4[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ruth-negga-loving-photocall-at-cannes-film-festival-5-16-2016-41-1.jpg)

![Joel-Edgerton-Ruth-Negga-Jeff-Nichols[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Joel-Edgerton-Ruth-Negga-Jeff-Nichols1.jpg)
![midnight_special_fr-91035[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight_special_fr-910351.jpg)
![midnight-special-affiche-407e7[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special-affiche-407e71.jpg)


![037230.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/037230.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![ht_midnight_special_film_still_mm_160401_16x9_992[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ht_midnight_special_film_still_mm_160401_16x9_9921.jpg)
![maxresdefault[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/maxresdefault1.jpg)
![media-title-Midni-30[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/media-title-Midni-301.jpg)
![media-title-Midni-35[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/media-title-Midni-351.jpg)
![media-title-Midni-36[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/media-title-Midni-361.jpg)
![Midnight Special Movie Set (1)[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Midnight-Special-Movie-Set-11.jpg)
![Midnight Special Movie Set (2)[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Midnight-Special-Movie-Set-21.jpg)
![midnightspecial[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight20special1.jpg)




![midnight_special_wb_2.0[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight_special_wb_2.01.jpg)
![midnight-special_5[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special_51.jpg)
![midnight-special_10[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special_101.jpg)
![midnight-special-film-fragmani-izle-2016-846[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special-film-fragmani-izle-2016-8461.jpg)
![midnight-special_12[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special_121.jpg)
![midnight-special_6[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special_61.jpg)
![midnight-special_4[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/midnight-special_41.jpg)
![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-100x75.png)

