Take Shelter de Jeff Nichols! Cosmique et obsédant!
![takeshelteraffiche[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/takeshelteraffiche1.jpg)
Titre original : Take Shelter
Réalisation : Jeff Nichols
Scénario : Jeff Nichols
Direction artistique : Jennifer Klide
Décors : Chad Keith
Costumes : Karen Malecki
Photographie : Adam Stone
Montage : Parke Gregg
Musique : David Wingo
Production : Sophia Lin et Tyler Davidson
Sociétés de production : Grove Hill Productions et Hydraulx Entertainment
Société de distribution : Sony Pictures Classics (États-Unis), Ad Vitam (France)
Budget : 5 000 000 de dollars
Pays d’origine : États-Unis
Langue originale : anglais
Genre : Drame
Durée : 120 minutes
Dates de sortie : 4 janvier 2012
Distribution : Michael Shannon, Jessica Chastain, Katy Mixon

Remarqué pour son premier long-métrage, Shotgun Stories, Jeff Nichols confirme son statut de cinéaste à suivre de près avec ce second très beau film.
Le cinéma indépendant américain récent réserve plus rarement qu’on ne le dit des surprises de la taille de Take Shelter. De celles prodiguées, par exemple, par un Vincent Gallo (The Brown Bunny, 2004), un David Gordon Green (L’Autre Rive, 2004) ou une Kelly Reichardt (La Dernière Piste, 2011), qui donnent l’impression de redécouvrir l’Amérique, avec sa poésie de l’espace, sa violence native, son lyrisme eschatologique. Révélé au mois de mai 2011 par la sélection très relevée de la Semaine de la critique au Festival de Cannes, Take Shelter est le deuxième long-métrage d’un réalisateur de 33 ans, Jeff Nichols, qui avait déjà signé en 2008, avec Shotgun Stories, une terrible tragédie familiale à ciel ouvert, dans les plaines de l’Arkansas.
![380024[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/3800241.jpg)
C’est encore la famille qui est au centre de ce nouveau film, dont le titre désigne, en même temps que le sujet du film, le premier impératif qui lui est associé : la mettre à l’abri. Tout père, toute mère, saisira d’emblée ce contre quoi cette disposition élémentaire est requise : le mystère et la précarité du monde qui nous environne, l’accident et le drame insidieusement tapis derrière la porte, l’angoisse diffuse qui en résulte. Rien, a priori, ne semble pourtant devoir inquiéter la famille LaForche. Curtis est ouvrier sur des chantiers de construction, Samantha, sa femme, est la grâce personnifiée, et leur fillette, Hannah, qui souffre de surdité, devrait, grâce à la mutuelle de santé de Curtis, pouvoir bénéficier d’une opération qui la tire d’affaire. Quoique de condition modeste, ils jouissent, quelque part dans cette banlieue de l’Ohio, d’une maison individuelle ouverte sur la campagne, qui leur procure abri et tranquillité.
![take-shelter-movie_Michael-Shannon-2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/take-shelter-movie_Michael-Shannon-21.jpg)
L’annonce de la catastrophe est pourtant là d’emblée, dès le plan d’ouverture du film, et Curtis est son prophète. Elle se manifeste par un désordre atmosphérique, qui amène avec lui d’inquiétantes perturbations climatiques. Gouttes de pluie jaune, ciel de plomb, nuée menaçante, vent qui se lève sont autant de signes qui se manifestent par intermittence à sa conscience, préfigurant l’approche d’un danger imminent dont on ne connaît pas l’exacte nature. Ce début de science-fiction, qui augure aussi bien du débarquement d’extraterrestres que de l’arrivée d’une tornade, va insensiblement se préciser. Car il apparaît bientôt que ces visions récurrentes que le spectateur partage avec Curtis, celui-ci est le seul à les percevoir. Ni sa femme, ni sa fille, ni ses collègues, ni personne, ne semblent, curieusement, les ressentir.
![take-shelter-michael-shannon-13-rcm0x1920u[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/take-shelter-michael-shannon-13-rcm0x1920u1.jpg)
Cette sourde angoisse qui le saisit à l’état de veille se double bientôt de cauchemars nocturnes terrifiants, avant que la révélation de son passé familial, renversant les apparences, n’établisse l’hypothèse d’une aliénation mentale. Aux lecteurs qui seraient tentés, à ce stade des opérations, de lyncher le critique divulgateur des mystères filmiques, on voudrait par avance préciser que Take Shelter n’est pas un film à twist (ce retournement final qui redéploie la lecture de l’oeuvre). D’abord parce que l’irruption de ce secret familial intervient suffisamment tôt dans la narration. Ensuite parce qu’elle n’annule pas l’interprétation initiale du film, mais s’y superpose.
![screenshot2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/screenshot21.jpg)
D’ailleurs, toute la puissance de Take Shelter vient de là. L’entrée dans la folie de Curtis ne rend pas pour autant ses hallucinations incompatibles avec la réalité. Ce n’est pas seulement que l’Etat de l’Ohio est régulièrement l’objet de tornades dévastatrices et meurtrières. C’est aussi que le cinéaste s’applique jusqu’au bout à nourrir le doute sur la nature des perceptions qu’il met en scène (reportage télévisuel sur un nuage toxique, tempête tour à tour fantasmée et réelle…). Le dérèglement ou l’accident écologique est à cet égard un vecteur très efficace : les spectacles apocalyptiques qu’il produit désormais à foison nous donnent aussi bien l’impression d’être entrés dans le cerveau d’un fou en proie à la vision du Jugement dernier.
![screenshot3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/screenshot31.jpg)
Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa femme et sa fille quand il devient sujet à de violents cauchemars. La menace d’une tornade l’obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit. Son comportement inexplicable fragilise son couple et provoque l’incompréhension de ses proches. Rien ne peut en effet vaincre la terreur qui l’habite…
![82435020160713135634[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/824350201607131356341.jpg)
Une tempête se prépare. Inquiétante. Alors que des éclairs fendent l’horizon en deux, la pluie, de couleur jaune, a une texture visqueuse. Tout cela n’est pourtant qu’un rêve, et lorsque Curtis se réveille, le ciel apparaît nettement moins menaçant. Pourtant, chez Curtis un trouble s’installe, lequel ne tarde pas à sombrer dans une forme de paranoïa. Dans Bug, le même acteur, Michel Shannon, voyait des insectes partout, ici, il est convaincu qu’un terrible orage se prépare pour tout détruire sur son passage.
![Michael Shannon Take Shelter[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Michael-Shannon-Take-Shelter1.png)
Mais la comparaison avec le film de William Friedkin s’arrête là. En effet, Jeff Nichols ne cherche pas à maintenir l’ambiguïté et préfère plutôt s’intéresser à la manière dont l’angoisse s’immisce chez le personnage. Et ça passe notamment par des scènes de cauchemar terrifiantes, qui ressortent comme de véritables trouées de violences dans le récit. Ces cauchemars, jugés prémonitoires par Curtis, vont ainsi venir troubler l’équilibre d’une famille sans histoire, pour ne pas dire banale, si on excepte la surdité de leur fille (qui donne d’ailleurs lieu à une très belle scène où le père prend soin de ne pas faire de bruit alors que l’enfant dort). Et bien que l’obsession du père devienne de plus en plus étouffante, elle ne se retourne jamais contre sa femme et sa fille. Au contraire, il agit sans cesse dans leur intérêt, notamment lorsqu’il décide de construire un abri pour les protéger. Car si la tempête approche, le couple, lui, résiste.
![movie-scene3[2]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/movie-scene32.jpg)
Il faut alors voir comme Samantha, à qui Jessica Chastain apporte une fragilité bouleversante, se tient sans cesse à côté de son mari, se bat pour sauver son couple, se montre incroyablement compréhensive, patiente, face à l’attitude de plus en plus tourmentée de son époux. L’amour qu’elle lui porte révèle ainsi une force insoupçonnée, qui culmine lors de scènes véritablement émouvantes. Et finalement, Take Shelter s’apparente à une très belle variation sur le couple. Porté par deux acteurs au meilleur de leur forme, le deuxième long de Jeff Nichols jouit par ailleurs d’une mise en scène admirable, d’une beauté à couper le souffle, en plus d’être servie par des effets spéciaux discrets mais convaincants (la tornade qui se forme dans le ciel, la nuée d’oiseaux au comportement étrange). Take Shelter se double en outre d’une critique sociale pertinente, l’arrivée de cette tempête se faisant alors métaphore d’une crise économique qui s’apprête à ravager le pays. Comme nombre de sorties en 2011, il est encore question d’apocalypse, l’histoire jouant elle aussi merveilleusement avec une dimension légèrement fantastique. Déjà persuadé d’avoir vu un grand film, c’est littéralement conquis que le spectateur sort de la salle après une séquence finale épatante que l’on n’aurait pas pu imaginer plus puissante…
![movie-take-shelter-thumb3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/movie-take-shelter-thumb31.png)
Jeff Nichols est l’un des rares réalisateurs à savoir filmer la famille avec un réalisme et une justesse déroutants. Il nous l’avait déjà prouvé avec Shotgun Stories, son premier film, qui montrait une guerre dans une fratrie et il le confirme avec Take Shelter. L’histoire suit une famille dont le père, sujet à des cauchemars apocalyptiques, cherche à tout prix à protéger sa famille.
![movie-take-shelter-thumb5[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/movie-take-shelter-thumb51.png)
Le scénario joue sur l’ambiguïté et nous laisse dans le doute : le héros est-il fou ou voit-il juste ? Très rapidement, les soupçons de schizophrénie sur l’état mental de Curtis LaForche sont introduits et confortés par le fait que, mis à part ses visions, rien ne laisse présager l’apocalypse. On sent Curtis totalement dérangé, mais Jeff Nichols ne rend jamais le personnage dangereux, mieux encore, il lui donne un aspect terriblement attachant : notre héros est toujours en train de chercher à protéger sa famille et de prendre les décisions les plus justes.
![ni7pEhc0lNm09gPyn2LV2KoheFn[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ni7pEhc0lNm09gPyn2LV2KoheFn1.jpg)
Jeff Nichols tire le portrait d’un homme complexe et toujours à la limite de la raison. Son long-métrage est un mélange des genres inédit : tour à tour film sur la schizophrénie ou drame familial, il termine par une note de pur fantastique. Dans chaque domaine le réalisateur prouve son talent et amène de l’originalité. Sa vision de la fin du monde est la plus originale portée à l’écran depuis bien longtemps (et pourtant des films traitant de ce sujet, il y en a eu des dizaines ces dernière années…). Son portrait familial est toujours juste et souvent tragique, voire effrayant. A cela s’ajoutent des scènes de fin du monde visuellement très abouties qui apportent, en plus de la tension omniprésente, une beauté graphique incontestable.
![take-shelter-movie_Michael-Shannon-1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/take-shelter-movie_Michael-Shannon-11.jpg)
Curtis Laforche, le père de famille, est interprété par Michael Shannon (Les Noces rebelles, Un Jour sans fin), qui joue pour la seconde fois dans un film de Jeff Nichols après Shotgun Stories. Son personnage est à la fois attachant, effrayant, troublant et s’amuse à jouer avec le spectateur. Pour lui donner la réplique, Jessica Chastain (The Tree of Life) joue sa femme. Un personnage pas évident au départ car soumis aux doutes et aux craintes quant à l’état de son mari, mais l’actrice s’en sort avec talent.
Ce n’est pas si souvent que le cinéma américain traite du mysticisme ou des failles de la raison – a fortiori des deux – sans les armes trop familières de la démonstration, voire de la propagande dans les cas extrêmes. Qu’il laisse alors circuler entre ses images un véritable doute propre à laisser l’esprit vagabonder. Pas assez souvent, en tout cas, pour ne pas saluer l’habileté de la démarche de Take Shelter, thriller fantastique dans le sens le plus pur du terme, où la frontière entre rationnel et irrationnel ne peut jamais être fixée à coup sûr.

La fin du monde, grande affaire du cinéma contemporain (de Roland Emmerich à Lars von Trier), trouve en Take Shelter une de ses expressions les plus saisissantes, originales et pourtant élémentaires.
Le film commence par une vision lancinante qui, par un simple mouvement de balancier, ne va cesser de revenir ébranler les certitudes d’un homme, en même temps que celles du spectateur.
Curtis LaForche, un père de famille paisible, modeste ouvrier pour une société de forage, bon chrétien, bon mari (Michael Shannon, immense), fait un cauchemar : il aperçoit, depuis son jardin, une tornade monumentale s’avancer inexorablement.
![takeshelter05[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/takeshelter051.jpg)
A son réveil, la sensation de réel est si forte qu’il finit par se convaincre du caractère prémonitoire de ce rêve bientôt récurrent et décide, pour protéger sa femme (Jessica Chastain, la droiture incarnée) et sa petite fille, de construire un abri au fond du jardin.
Seul contre tous. Détail d’importance, il habite l’Ohio, Etat déshérité du Midwest dont les vastes plaines au ciel bleu figurent la plus terrifiante des prisons : sans rien pour entraver ce paysage immense, le danger peut venir de partout, de l’horizon ou de l’azur, du proche ou du lointain, de Dieu ou d’un chien ; seul le sous-sol pourrait constituer un abri (“shelter” en anglais), et encore.
![takeshelter02[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/takeshelter021.jpg)
Ainsi, les grands espaces jadis synonymes de liberté et de puissance pour l’homme américain deviennent ici sa damnation.
Une fois ceci posé, en quelques plans d’une beauté axiomatique, Take Shelter se déploie majestueusement, avec l’implacable tranquillité des grandes tragédies, et Jeff Nichols de s’imposer, après l’excellent Shotgun Stories en 2007, comme le plus grand espoir du cinéma américain, dans la noble lignée Ford-Cimino-Malick (ce dernier étant son protecteur officiel).
On le comprend vite, l’Apocalypse n’est pas son sujet, tout comme il n’était pas celui du Phénomènes de Shyamalan, auquel on pense nécessairement : c’est sous le crâne de LaForche que la véritable tempête fait rage.
![takeshelter03[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/takeshelter031.jpg)
Les scènes proprement catastrophiques sont réduites à leur plus simple – mais terrifiante – expression (quelques gouttes jaunâtres sur un poignet, du vent dans les feuilles, des aboiements et des cris d’oiseaux, des silhouettes à peine discernables à travers une vitre embuée…), et plutôt que de chercher à concurrencer Hollywood sur son terrain spectaculaire, Nichols se rive au quotidien.
Si la menace demeure abstraite, inscrivant le film dans une dimension cosmique, ses effets sont on ne peut plus concrets : de la consultation d’un psychologue à la visite (bouleversante) d’une mère schizophrène pour s’enquérir d’éventuels antécédents, de la honte d’un drap mouillé par la pisse à la crainte de ne pouvoir payer les traites à la fin du mois, les personnages sont englués dans des soucis quotidiens.
![takeshelter04[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/takeshelter041.jpg)
Il faut insister sur cette qualité car, pour aussi déceptive qu’elle soit – le film ne vise nullement la sidération, il est plutôt de ceux qui obsède encore des jours après la projection –, elle est extrêmement précieuse.
C’est parce que le film ne quitte jamais le terrain du réalisme – pas plus que le territoire réduit de sa petite communauté soudée – que ses visions, et notamment la dernière, sont à ce point terrassantes.
On saisit mieux la singularité de Take Shelter en le comparant à Bug de William Friedkin, où l’on avait découvert en 2007 Michael Shannon dans le rôle proche d’un homme à la folie contaminatrice.
![take-shelter1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/take-shelter11.jpg)
Les deux films empruntent des chemins on ne peut plus opposés : à l’emballement hystérique de Friedkin, Nichols répond par l’apaisement familial (sublime scène où Jessica Chastain prend les choses en main) ; au théâtre psychologique, il préfère la politique du geste (grande idée que d’imaginer un enfant sourd et muet avec qui l’on ne peut communiquer que par signes) ; à la défiance paranoïaque, enfin, il oppose l’empathie et le doute (puisque la folie de Shannon n’est jamais certifiée).
![take-shelter[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/take-shelter1.jpg)
Il faut l’avouer : à l’appréhension de ces domaines si régulièrement maltraités par un cinéma aussi friand de certitudes que le cinéma américain, s’ajoutait la présence menaçante d’un comédien doué, mais enclin au cabotinage au contact d’un archétype devenu trop familier – soit Michael Shannon dans un énième rôle d’Américain halluciné (après Bug, World Trade Center, Les Noces rebelles…). Cependant, Shannon fait ici honneur à une partition écrite plus finement que les autres, sur un mode moins théâtral, par le réalisateur Jeff Nichols qui le dirige de nouveau, après son précédent et premier long métrage Shotgun Stories. Son personnage est un quidam tout à fait ordinaire, mari et père concerné, ouvrier de chantier, dont les nuits et bientôt les jours sont hantés par des visions de catastrophes et de menaces sur sa famille et sa communauté. Leur persistance le conduisant à les prendre pour prémonitoires, il s’attelle à la sécurisation de son foyer, sous le regard impuissant de son entourage observant son comportement de plus en plus obsessionnel et paranoïaque – notamment à la restauration de l’abri anti-tempête enfoui dans son jardin… tout en consultant néanmoins un psychiatre, trop conscient des doutes planant sur son état mental.
![takeshelter01[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/takeshelter011.jpg)
Cette double vie du personnage, à la fois socialement intégré et glissant dans un monde semble-t-il basé sur des chimères, se refusant à choisir entre la raison (du moins ce que lui dicte la voix de la normalité) et l’irrationnel (illusoire ou prémonitoire, on l’ignore), est à l’image de l’ambivalence savamment cultivée par Take Shelter, qui laisse constamment cohabiter les hypothèses « psychose » et « prescience » en minimisant la discrimination entre elles. Ainsi laisse-t-il les visions mentales du personnage faire irruption dans les images du factuel, en raccords cut et avec un minimum d’effets, parfois même sans transition (les scènes de réveils en sursaut ne sont pas systématiques), avant de les laisser suggérer dans le hors-champ créé par le regard perdu de Shannon, par les sons d’origine douteuse qui attirent son attention. Face à cette situation personnelle insaisissable, la réaction de la normalité (l’épouse, les proches, les collègues) prend elle aussi un double sens, hésitant entre gêne face à un comportement potentiellement néfaste et répression contre ce qui sort de son cadre (voir comment, vers la fin, l’épouse doit se comporter avec son mari comme une mère).
![380024[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/3800241.jpg)
L’ambiguïté ainsi entretenue contamine jusqu’aux scènes les plus attendues de ce genre et de ces domaines dans le cinéma américain. Ainsi, dans tout autre film de ce cinéma sur des troubles mentaux, une crise de rage comme celle qui saisit Shannon au milieu de ses concitoyens et officialise sa démarcation de la communauté ne serait qu’un passage obligatoire, forcé voire caricatural pour stigmatiser l’« anormal » (à Hollywood, même les autistes n’y échappent pas). Or ici, les doutes qui empreignent Take Shelter désamorcent tout sous-entendu moralisateur : le statut du personnage – psychotique ou prophète – demeure indécis, et ses réactions continuent de manifester la pleine conscience des deux perceptions du réel qui l’habitent. Et puis, la scène finale, pirouette ultime qui aurait pu décider – choix facile – de donner une réponse-surprise aux doutes ayant parcouru le film, choisit malicieusement de prolonger, voire de propager ces mêmes doutes. Point final, mais de suspension, adéquat pour un film habile à mettre en scène la part indécidable – néanmoins tenace – d’angoisses intimes.
![take-shelter-movie_Michael-Shannon-1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/take-shelter-movie_Michael-Shannon-11.jpg)
Pourquoi un père de famille est-il soudain persuadé qu’une tornade va ravager le coin perdu où il vit ? Curtis fait des cauchemars où la pluie tombe dru et jaune, où le gros chien de la famille l’attaque. Est-il rattrapé par cette « schizophrénie paranoïde » qui a frappé sa mère dans sa trentaine ? Jeff Nichols, nouvel auteur prodige, gagne à ne pas s’arrêter à cette hypothèse clinique et à flirter avec l’allégorie : Take shelter parle d’une Amérique fragilisée, obsédée par son déclassement, sa ruine. Le film fait se répondre les angoisses du héros et toutes sortes de périls extérieurs, du dérèglement climatique à la catastrophe écologique, en passant par la crise économique.
![takeshelterevenement[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/takeshelterevenement1.jpg)
La fragilité s’incarne aussi dans la surdité de la fille du couple. Une opération est nécessaire, et la mutuelle, indispensable. Mais combien de temps le père pourra-t-il garder son travail ? Tout se passe comme si la peur de perdre quelque chose créait les conditions d’une perte plus grande. Le foyer américain de base n’est plus qu’un fétu de paille. Michael Shannon et Jessica Chastain en sont les représentants blêmes et bouleversants, l’inquiétude fichée dans le regard.
![takeshelter03[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/takeshelter031.jpg)
Or, quand le film confronte ses personnages à une tempête bien réelle, rien ne se passe comme prévu, et un nouveau gouffre s’ouvre. Dans des films tels que Les Moissons du ciel (de Terrence Malick) ou Magnolia (de Paul Thomas Anderson), l’apocalypse venait surprendre et punir des êtres ou une civilisation se sachant coupables. Avec Take shelter et son dénouement vertigineux, on est dans une ère nouvelle, encore difficile à appréhender : la fin du monde est autant redoutée que désirée par une humanité qui n’a pas grand-chose à se reprocher, sinon d’avoir perdu toute confiance en elle-même.
![ni7pEhc0lNm09gPyn2LV2KoheFn[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ni7pEhc0lNm09gPyn2LV2KoheFn1.jpg)
Jeff Nichols transforme l’essai et signe un second film d’une réussite totale. Take Shelter est une œuvre magnifique, un film fantastique qui joue avec le spectateur tout en le menant en bateau jusqu’à un final grandiose. Le film est mené de main de maître par Michael Shannon dans le rôle d’un père paniqué et prêt à tout pour sauver sa famille. Du grand cinéma.
![takeshelter02[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/take20shelter20021.jpg)
![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-300x194.png)
![Super Charlie de Jon Holmberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Super-Charlie-affiche2-100x75.png)
![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-100x75.jpg)

![The Brutalist de Brady Corbet [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Brutalist-affiche-100x75.jpg)
![Red Bird de Alexandre Laugier, Thomas Habibes et Houssam Adili [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Red-Bird-affiche-100x75.jpg)
![Greenland : Migration de Ric Roman Waugh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Greenland-Migration-affiche-100x75.jpg)

![PRIMATE de Johannes Roberts [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Primate-affiche-100x75.jpg)









![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-300x194.jpg)

![Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés de Rian Johnson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Wake-Uo-Dead-man-affiche-100x75.jpg)
![Troll 2 de Roar Uthaug [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Troll2-affiche-100x75.jpg)
![Jay Kelly de Noah Baumbach [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Jay-Kelly-affiche-100x75.jpg)
![Train Dreams de Clint Bentley [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Train-Dreams-affiche-100x75.jpg)
![Le Fils de Mille Hommes de Daniel Rezende [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Le-fils-de-mille-hommes-affiches-100x75.jpg)
![Frankenstein de Guillermo Del Toro [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Frankenstein-affiche-100x75.jpg)

![Carol de Todd Haynes [édition limitée]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Carol-01-100x75.png)
![Eddington d’Ari Aster [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Eddington-affiche-100x75.jpg)

![Thunderbolts* de Jake Schreier [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/09/Thunderbolts-affiche-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Dahomey de Mati Diop](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/06/1695-100x75.jpg)
![Here de Robert Zemeckis [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/03/Here-affiche-100x75.jpg)
![Die Alone de Lowell Dean [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/02/Die-Alone-affiche-100x75.jpg)





![Until Dawn: La mort sans fin de David F. Sandberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/05/Until-Dawn-affiche-100x75.jpg)

![Minecraft, le film de Jared Hess [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/04/Minecraft-Affiche-100x75.png)












![takeshelteraffiche[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/takeshelteraffiche1.jpg)
![scIxMjTnlDrC9KcddIhW68w1eGY[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/scIxMjTnlDrC9KcddIhW68w1eGY1.jpg)
![locandina[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/locandina1.jpg)
![scIxMjTnlDrC9KcddIhW68w1eGY[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/scIxMjTnlDrC9KcddIhW68w1eGY1.jpg)




![arton1772-980x0[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/arton1772-980x01.jpg)
![684950474f447871e51e27401d5131e5[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/684950474f447871e51e27401d5131e51.jpg)
![00210fbd[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/00210fbd1.jpg)
![979b1586c0454e66ef278d2f9a1357a98a51c1d0[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/979b1586c0454e66ef278d2f9a1357a98a51c1d01.jpg)
![film_Shotgun-Stories02[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/film_Shotgun-Stories021.jpg)
![shot1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/shot11.png)
![shot2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/shot21.png)
![shotgunstories2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/shotgunstories21.jpg)
![shotgun-stories-1-rcm0x1920u[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/shotgun-stories-1-rcm0x1920u1.jpg)
![mud_affiche_gd_format[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/mud_affiche_gd_format1.jpg)
![mud_affiche_gd_format[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/mud_affiche_gd_format1.jpg)

![Mud_sur_les_rives_du_Mississippi[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Mud_sur_les_rives_du_Mississippi1.jpg)
![mud_image_2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/mud_image_21.jpg)
![mud-sur-les-rives-du-mississippi-photo[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/mud-sur-les-rives-du-mississippi-photo1.jpg)
![mud_image_1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/mud_image_11.jpg)
![MUD_4[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/MUD_41.jpg)
![6722108[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/67221081.jpg)
![109310[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/1093101.jpg)
![Mud-05[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Mud-051.jpg)
![Mud02[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Mud021.png)
![257394.ogfb[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/257394.ogfb1_.jpg)


![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18337428_120332000609910654_1254544363_n1-2.png)
![1_photo_film_le_caire_confidentiel_r_atmo_rights39-2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/1_photo_film_le_caire_confidentiel_r_atmo_rights39-21.jpg)
![2_Photo-film-LE-CAIRE-CONFIDENTIEL[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/2_Photo-film-LE-CAIRE-CONFIDENTIEL1.jpg)
![4_photo_film_le_caire_confidentiel_r_atmo_rights30[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/4_photo_film_le_caire_confidentiel_r_atmo_rights301.jpg)
![170704_22....multimediaarticles170629KoblicDeaPlaneta4554664[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/170704_22....multimediaarticles170629KoblicDeaPlaneta45546641.jpg)
![1491317709076_0570x0400_1491317818903[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/1491317709076_0570x0400_14913178189031.jpg)
![le_caire_confidentiel[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/le_caire_confidentiel1.jpg)
![5_photo_film_le_caire_confidentiel_r_atmo_rights22[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/5_photo_film_le_caire_confidentiel_r_atmo_rights221.jpg)
![entre_2_rives[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/entre_2_rives1.jpg)
![entre_2_rives[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/entre_2_rives1.jpg)
![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18337428_120332000609910654_1254544363_n1.png)
![entre-deux-rives-8-620x335[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/entre-deux-rives-8-620x3351.jpg)
![thenet-gal1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/thenet-gal11.png)
![thenet-gal2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/thenet-gal21.png)
![thenet-gal3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/thenet-gal31.png)
![thenet-gal4[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/thenet-gal41.png)
![thenet-gal5[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/thenet-gal51.png)
![thenet-gal6[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/thenet-gal61.png)
![thenet-gal8[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/thenet-gal81.png)
![ko_affiche-2-4bc22[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ko_affiche-2-4bc221.jpg)
![ko_affiche-2-4bc22[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ko_affiche-2-4bc221.jpg)
![18361741_120332000636629455_1425320810_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18361741_120332000636629455_1425320810_n1.png)
![K.O_film_Lafitte[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/K.O_film_Lafitte1.jpg)
![ko_01[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ko_011.jpg)
![ko_02-copie-1300x867[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ko_02-copie-1300x8671.jpg)
![ko02[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ko021.jpg)
![ko06[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ko061.jpg)
![ko07[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ko071.jpg)
![k-o-laurent-laffite-chiara-mastroianni[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/k-o-laurent-laffite-chiara-mastroianni1.jpg)
![K.O.-Bande-Annonce-Laurent-Lafitte-Thriller-2017[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/K.O.-Bande-Annonce-Laurent-Lafitte-Thriller-20171.jpg)
![3358291-laurent-lafitte-pio-marmai-fabrice-gob-675x0-1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/3358291-laurent-lafitte-pio-marmai-fabrice-gob-675x0-11-1.jpg)
![sans_pitie_affiche_francaise--70eb1[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/sans_pitie_affiche_francaise-70eb11.jpg)
![sans_pitie_affiche_cannes_2017-bcf46[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/sans_pitie_affiche_cannes_2017-bcf461.jpg)
![5U9tIUpdrQnRlzdDQfKAOm8DwF5[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/5U9tIUpdrQnRlzdDQfKAOm8DwF51.jpg)
![1344699_backdrop_scale_1280xauto[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/1344699_backdrop_scale_1280xauto1.jpg) Difficile de résumer Sans Pitié, qui avance masqué, absolument pas de façon rectiligne. C’est un polar à l’image du cinéma coréen, souvent trop généreux : les deux heures qu’il dure sont un peu exagérées en raison d’un scénario qui multiplie les allers-retours entre présent et différents passés, à la manière d’un film de Tarantino –sans les chapitres, mais avec les indications de temps. On pardonnera aisément à Sung-hyun Byun qui fait par ailleurs preuve d’un sens aigu du cadrage et des raccords vertigineux avec toujours le souci d’en donner pour son argent au spectateur. Un précis d’esthétique, tarantinien donc, qui fait aussi des emprunts au cinéma hongkongais des années 90-00, bourré de testostérone, de violence graphique et de séquences déconstruites.
Difficile de résumer Sans Pitié, qui avance masqué, absolument pas de façon rectiligne. C’est un polar à l’image du cinéma coréen, souvent trop généreux : les deux heures qu’il dure sont un peu exagérées en raison d’un scénario qui multiplie les allers-retours entre présent et différents passés, à la manière d’un film de Tarantino –sans les chapitres, mais avec les indications de temps. On pardonnera aisément à Sung-hyun Byun qui fait par ailleurs preuve d’un sens aigu du cadrage et des raccords vertigineux avec toujours le souci d’en donner pour son argent au spectateur. Un précis d’esthétique, tarantinien donc, qui fait aussi des emprunts au cinéma hongkongais des années 90-00, bourré de testostérone, de violence graphique et de séquences déconstruites.![Sans-pitié-Cannes-2017-700x336[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Sans-pitié-Cannes-2017-700x3361.jpg)
![sans-pitie-la-critique-festival-de-cannes-2017[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/sans-pitie-la-critique-festival-de-cannes-20171.jpg)
![the_merciless_photo_du_film_[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/the_merciless_photo_du_film_1.jpg)
![sans_pitie_affiche_francaise--70eb1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/sans_pitie_affiche_francaise-70eb11.jpg)
![444178-f7f23[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/444178-f7f231.jpg)
![444178-f7f23[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/444178-f7f231.jpg)
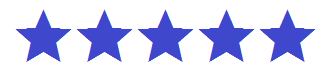
![9byxVCusEBSMFy9joVrrbeaFrR4[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/9byxVCusEBSMFy9joVrrbeaFrR41.jpg)
![20_000_jours_bandeau_585[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/20_000_jours_bandeau_5851.jpg)
![20-000-jours-sur-terre-001[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/20-000-jours-sur-terre-0011.jpg)
![20-000-JOURS-SUR-TERRE-10-copie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/20-000-JOURS-SUR-TERRE-10-copie1.jpg)
![20-000-jours-sur-terre-de-iain-forsyth-et-jane-pollard-sortie-14-decembre-2014_5171951[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/20-000-jours-sur-terre-de-iain-forsyth-et-jane-pollard-sortie-14-decembre-2014_51719511.jpg)
![5040-20-000-jours-sur-terre[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/5040-20-000-jours-sur-terre1.jpg)
![5043-20-000-jours-sur-terre[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/5043-20-000-jours-sur-terre1.jpg)
![5051-20-000-jours-sur-terre[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/5051-20-000-jours-sur-terre1.jpg)
![5050-20-000-jours-sur-terre[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/5050-20-000-jours-sur-terre1.jpg)
![20000-jours-3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/20000-jours-31.jpg)
![20000-jours-4[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/20000-jours-41.jpg)
![20000jourssurterre604-tt-width-604-height-410-bgcolor-000000[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/20000jourssurterre604-tt-width-604-height-410-bgcolor-0000001.jpg)
![20000joursterre_ifjp[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/20000joursterre_ifjp1.jpg)
![106810[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/1068101.jpg)
![326794[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/3267941.jpg)
![357873[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/3578731.jpg)
![cave-2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/cave-21.jpg)
![4959571[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/49595711.jpg)
![_c_happiness_distribution-e51f3[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/c_happiness_distribution-e51f31.jpg)
![_c_happiness_distribution-e51f3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/c_happiness_distribution-e51f31.jpg)
![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/18337428_120332000609910654_1254544363_n1-3.png)
![1A979B9F-4B05-491F-A378-098D47F2DC61_cx3_cy9_cw90_mw1024_s_n_r1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/1A979B9F-4B05-491F-A378-098D47F2DC61_cx3_cy9_cw90_mw1024_s_n_r11.jpg)
![7ZcZPmctQpIyo4OwX6gvG7N3Gq5[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/7ZcZPmctQpIyo4OwX6gvG7N3Gq51.jpg)
![186819[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/1868191.jpg)
![300937_1024_janis_a_janis_joplin_sztori__2_[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/300937_1024_janis_a_janis_joplin_sztori__2_1.jpg)
![534775[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/5347751.jpg)
![535868[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/5358681.jpg)
![janis_joplin[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/janis_joplin1.png)
![janis-joplin[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/janis-joplin1.jpeg)
![JanisJoplin_620_101712[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/JanisJoplin_620_1017121.jpg)
![janis-joplin-740x350[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/janis-joplin-740x3501.jpg)
![janis-joplin-walk-of-fame[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/janis-joplin-walk-of-fame1.jpg)
![tumblr_oev9keI2y01vt291ho1_1280[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/tumblr_oev9keI2y01vt291ho1_12801.jpg)

![sugar_man_affiche[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/sugar_man_affiche1.jpg)
![sugar_man_affiche[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/sugar_man_affiche1.jpg)
![sugar_man_photo_2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/sugar_man_photo_21.jpg)
![1akfcsearchingforsugar2-man[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/1akfcsearchingforsugar2-man1.jpg)
![8a66eefaf5ff515f4eb317e01f17ca71[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/8a66eefaf5ff515f4eb317e01f17ca711.jpg)
![67dea0a7-751f-4f68-9768-21e8ab105040-2060x1236[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/67dea0a7-751f-4f68-9768-21e8ab105040-2060x12361.jpg)
![b79f4e5c0cfe2a672cfbcf4f227655b4[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/b79f4e5c0cfe2a672cfbcf4f227655b41.jpg)
![film_investing_Sugar-Man[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/film_investing_Sugar-Man1.jpg)
![rodriguez[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/rodriguez1.jpg)
![RodriguezPerforming[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/RodriguezPerforming1.jpg)
![Sixto-Rodriguez1-704x400[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/Sixto-Rodriguez1-704x4001.jpg)
![sixto-diaz-rodriguez-a-mexican-american-folk-musician-from[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/sixto-diaz-rodriguez-a-mexican-american-folk-musician-from1.jpg)
![Sugarman-001-1036x583[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/06/Sugarman-001-1036x5831.jpg)



![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-100x75.png)

