THE CIRCLE
![18361741_120332000636629455_1425320810_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/18361741_120332000636629455_1425320810_n1.png)
Titre original : The Circle
Réalisation : James Ponsoldt
Scénario : James Ponsoldt et Dave Eggers, d’après le roman The Circle de Dave Eggers
Photographie : Matthew Libatique
Décors : Gerald Sullivan
Musique : Danny Elfman
Montage : Lisa Lassek
Production : Tom Hanks, Gary Goetzman, Laurie MacDonald, Walter Parkes
Sociétés de production : Likely story, Playtone, Route One Entertainment
Sociétés de distribution : EuropaCorp (États-Unis), Mars Films (France)
Pays d’origine : États-Unis, Émirats arabes unis1
Langue originale : anglais
Genres : techno-thriller, drame, science-fiction, dystopie
Durée : 110 minutes
Dates de sortie : 12 juillet 2017
Distribution: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Annie Allerton, Ellar Coltrane, Patton Oswalt, Glenne Headly, Bill Paxton

THESE
« Attention : les réseaux sociaux, c’est dangereux ! » pourrait être le sous-titre de The Circle, thriller de James Ponsoldt (Smashed, The Spectacular Now) où Emma Watson découvre les possibilités immenses et terrifiantes d’une entreprise dirigée par Tom Hanks. Un sujet dans l’air du temps certes, mais un film beaucoup trop convenu pour mériter le détour.
Sur le papier, The Circle s’inscrit dans la lignée de Black Mirror, l’excellente anthologie d’anticipation qui aborde avec malice et intelligence les dérives de la technologie. En réalité, c’est plus proche de Traque sur internet avec Sandra Bullock pourchassée par de méchants cyberterroristes des années 90 : un thriller un peu bête et très simpliste, parfois amusant mais profondément limité, qui offre quelques menus frissons quand il n’exaspère pas par ses facilités et incohérences.
![the-circle-nuovo-trailer-italiano-del-film-con-tom-hanks-e-emma-watson[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-nuovo-trailer-italiano-del-film-con-tom-hanks-e-emma-watson1-1.jpg)
The Circle est le nom d’une glorieuse entreprise américaine à la Google, qui ressemble à une grande secte érigée dans la Silicon Valley. Badges dernier cri, grandes baies vitrées, moyenne d’âge proche de celle d’une fac, ambiance collégiale, activités multiples disponibles sur une sorte de campus digne d’un paradis pour la génération Y : le décor d’un cauchemar 2.0 est planté. Pauvre petite chose innocente, Mae (Emma Watson) y décroche enfin un travail avec l’espoir d’arranger sa vie ordinaire. Le début d’une plongée dans les coulisses et ambitions de ce Cercle diabolique, dans une ambiance de film d’anticipation.

The Circle ressemble plus à Nerve, le teen movie coloré avec Emma Roberts sur un méchant jeu en ligne qui pousse des ados à être très bêtes, qu’à un film ténébreux et effrayant sur notre futur. Et si la présence de Tom Hanks laissait planer un doute, mieux vaut savoir d’emblée que le prestigieux acteur a très peu de temps à l’écran. The Circle est le film d’Emma Watson, qui est de chaque image, et en accentue tous les défauts.
Le film de James Ponsoldt ressemble plus à un téléfilm qu’à une œuvre de cinéma, la faute principalement à une écriture grossière loin d’être à la hauteur des ambitions. Du père gravement malade (Bill Paxton dans son dernier rôle au cinéma) à l’ex (Ellar Coltrane dans l’un de ses premiers rôles depuis Boyhood) anti-technologie placé de manière artificielle comme un curseur moral, en passant par les péripéties qui poussent l’héroïne à avancer, le scénario ressemble à une mauvaise copie scolaire du thriller type. Ce qui ne serait pas un réel problème si The Circle était capable d’appliquer la méthode avec soin et efficacité.
![the-circle-movie-trailer-screencaps-emma-watson[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-movie-trailer-screencaps-emma-watson1-1.png)
L’une des explications à ce film bizarrement troussé, qui semble avoir été privé de morceaux importants de son histoire, est probablement à chercher dans le livre éponyme de Dave Eggers, co-scénariste avec le réalisateur. De nombreux éléments ont sans surprise été retirés ou modifiés, mais certains ont finalement changé le sens et le discours du film, notamment en ce qui concerne le personnage de Mae.
Le livre The Circle était plus sombre et dérangeant, et certainement trop sombre et dérangeant pour un film à 18 millions avec Emma Watson vendu à un jeune public – censé partager son enthousiasme sur les réseaux sociaux donc. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si quelques mois avant la sortie, des reshoots ont été lancés après plusieurs projections tests où le personnage de Mae avait été jugé comme trop peu sympathique : The Circle devait être un produit facilement consommable et lisible, sans zone d’ombre. Chose particulièrement étonnante puisque les choix de l’héroïne, dans le film et surtout dans le livre, sont particulièrement tordus.
![emma-watson-the-circle-movie-photos-and-posters-1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/emma-watson-the-circle-movie-photos-and-posters-11-2.jpg)
The Circle arrive donc avec quelques années de retard pour commenter avec une telle naïveté et simplicité l’avènement des réseaux sociaux et de la nouvelle réalité qu’ils ont façonnée. Lorsqu’il explique que partager sa vie avec des milliers d’étrangers est une forme de prison, et que l’hystérie collective qui en naît est potentiellement dangereuse, le film manque cruellement de finesse. Lorsqu’il évoque des choses plus profondes (la question de la transparence cynique des politiciens, les limites de la liberté et de l’éthique lorsqu’il s’agit de protéger les enfants, les ambitions d’une super-entreprise type Google), le sujet est vite évacué.
![the-circle-movie-image-emma-watson-3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-movie-image-emma-watson-31-1.png)
Emma Watson n’aide pas à rendre le thriller plus crédible. Comme dans Regression d’Alejandro Amenabar, l’actrice se montre incapable d’interpréter un personnage aux multiples facettes. Elle se contente donc d’afficher une petite moue embêtée, froncer les sourcils et offrir un regard de petite chose fragile ou contrariée, à tel point que son visage est virtuellement le même entre le début et la fin, malgré la tournure des événements. En comparaison et malgré un rôle mineur, Karen Gillan offre nettement plus de nuances et d’énergie.
![the-circle-movie-emma-watson[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-movie-emma-watson1.png)
Si The Circle se laisse regarder avec un certain amusement presque régressif, il n’en reste pas moins raté et dispensable. Une seule envie à la sortie : relancer Nosedive, le fantastique épisode de la saison 3 de Black Mirror, réalisé par Joe Wright et avec Bryce Dallas Howard, où le même sujet est abordé avec mille fois plus d’inventivité.
Résumé
Un thriller téléphoné et inoffensif, pas bien fin ni malin, qui déroule une intrigue cousue de fil blanc et profondément naïve. Avec plus d’audace et de fidélité au livre, The Circle aurait pu être diablement plaisant ; en l’état, avec une Emma Watson aussi charismatique qu’un verre d’eau tiède, c’est digne d’un téléfilm.
![thecircle-movie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/thecircle-movie1.jpg)
Les États-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Pour elle, c’est une opportunité en or ! Tandis qu’elle prend de plus en plus de responsabilités, le fondateur de l’entreprise, Eamon Bailey, l’encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l’éthique et des libertés individuelles. Désormais, les choix que fait Mae dans le cadre de cette expérience impactent l’avenir de ses amis, de ses proches et de l’humanité tout entière…
![emma-watson-the-circle-movie-image-[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/emma-watson-the-circle-movie-image-1-2.png)
Le scénario de The Circle part d’un constat certes lucide mais difficile à admettre : l’Homme, de tout temps, a toujours réussi l’exploit douteux de gâcher ses plus belles créations. C’est ainsi qu’une bonne idée, censée améliorer la vie du terrien lambda, devient une bombe à retardement dès qu’elle est dans les mains de l’homme providentiel chargé d’en tirer le maximum d’avantages. Ainsi, si Internet est à n’en pas douter une invention de premier ordre (ce n’est pas à la rédaction d’un site comme le nôtre que nous dirons le contraire) force est de reconnaître qu’il n’a pas résisté longtemps aux pires dérives. Terrorisme, pédopornographique, harcèlement en ligne…le pire de l’être humain a trouvé en la toile une complice involontaire qui aide à son épanouissement. Quelle sera la suite ?
![The-Circle-2017-Movie-Free-Download-HD-Cam-2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Circle-2017-Movie-Free-Download-HD-Cam-21.jpg)
ANTITHESE
Dans le monde de The Circle, une entreprise qui se situe entre Google et Facebook, tenue par un Tom Hanks énigmatique, les réseaux sociaux ont franchi le pas sans complexe. La vie privée n’existe plus et vos moindres faits et gestes sont observés par des millions de personnes. Bientôt, les portables seront inutiles puisque la peau elle-même sera connectée. Au mépris de l’individualité, de ce qui fait l’essence même de votre personnalité, détruite au profit du sacro-saint sens commun. Oubliez donc votre âme : le réseau vous obligera peu à peu à vous accommoder à ses exigences. Et avec votre consentement, qui plus est ! Serait-ce une vision improbable de l’avenir ? Peut-être pas tant que ça…
![Emma-Watson-and-Karen-Gillan-in-The-Circle[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/Emma-Watson-and-Karen-Gillan-in-The-Circle1.jpg)
Grâce à une mise en scène efficace qui fait du spectateur un voyeur et du grand écran une reproduction à grande échelle de nos portables et ordinateurs, The Circle est d’un réalisme à toute épreuve. Il faut au moins ça pour faire oublier un sacré manque de rythme. La description détaillée de l’univers de l’entreprise qui, comme Google, offre l’opportunité à ses plus modestes collaborateurs d’avoir l’esprit « corporate », est certes intéressante et nécessaire mais beaucoup trop longue. S’il s’agit avant tout de montrer l’ascension du personnage campé par Emma Watson, qui passe du poste de secrétaire à celui d’associée d’une entreprise milliardaire, force est de reconnaître que le rythme trop tranquille aura tendance à en lasser plus d’un. Tout comme le traitement réservé aux personnages secondaires, voire même à l’ensemble du casting. Ou quand les acteurs disparaissent au profit du réseau, rendant impossible toute tentative pour se projeter dans cette vie future.
![The-Circle-12[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Circle-121.jpg)
C’est le choix déroutant qu’a fait le réalisateur James Ponsoldt : privilégier le réseau social, principal acteur du film, au détriment des personnages. Si Emma Watson a la chance d’avoir assez de temps d’antenne pour proposer une vraie composition, ses comparses restent dans l’ombre, voyant leurs rôles réduits à l’ébauche, là où l’on attend un minimum de détails. Ainsi, John Boyega, Karen Gillan et Tom Hanks lui-même voient leurs personnages disparaître au profit d’un média imaginaire qui, en monopolisant l’attention, devient vite agaçant. Si le passage de témoin, assez symbolique, entre l’ancienne et la nouvelle génération d’acteurs peut sembler prometteur (tout le marketing autour du film repose d’ailleurs là-dessus), le long-métrage ne remplit pas assez sa mission et le scénario est trop bancal pour que The Circle marque vraiment les esprits.
![emma-watson-the-circle-movie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/emma-watson-the-circle-movie1.jpg)
Pire encore : il s’agit du rôle de trop pour Emma Watson. Certes, elle est toujours aussi convaincante, mais reste une nouvelle fois dans sa zone de confort. Tous les personnages que l’actrice interprète sont le reflet d’un caractère que le monde entier connait : elle est intelligente, bibliophile, féministe…Il serait peut-être temps pour elle de se mettre en danger car, rapidement, son aura risque d’en pâtir.
Efficace malgré tout, The Circle n’entraînera malheureusement pas la prise de conscience que son réalisateur pouvait espérer. Oui, la vie privée est menacée par Internet les réseaux sociaux. Mais en évoquant plus les avantages que les inconvénients et en misant sur une fin décevante, le film se perd, étouffé par ses bonnes intentions. Ce n’est pas cela qui va empêcher un monde ultra-connecté d’évoluer . Au dépend de la vie privée ? Il est peut-être déjà trop tard.
![hero_Circle-2017[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/hero_Circle-20171.jpg)
SYNTHESE
The Circle met en avant le grand dilemme des sociétés occidentales actuelles à travers une cité totalement à part du monde réel. Cette entreprise qui devient un village interpelle le plus profond de nos esprits dans cette éternelle question qui subsiste, à savoir : sécurité ou liberté, qui a la priorité ? Le créateur de l’entreprise vend d’ailleurs cette innovation comme plus proche des droits de l’homme puisqu’elle sera utilisée pour renforcer la quiétude des populations. C’est l’occasion de voir ici deux idées s’affronter afin de déterminer la limite de ce système. Est ce que là où s’achève la surveillance, commence la vie privée ? Ou est ce que cette surveillance ne parviendrait-elle pas à nous canaliser ?
![20161206183156-thecirclemovie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/20161206183156-thecirclemovie1.jpg)
Dans le film, la jeune fille jouée par Emma Watson dit elle-même que lorsqu’elle n’est pas observée, son comportement se tourne naturellement vers les risques. Les caméras la sauvent alors de la situation dans laquelle elle s’est mise. Là encore vient se poser une question à propos du regard des autres. Tout comme sur les réseaux sociaux actuels, la peur d’être mal jugé peut amener les comportements à changer et de ce fait imposer un contrôle total de sa personne lorsque l’on se sait surveillé. Mais la liberté dans tout ça ? L’idée de transparence totale pourrait être bonne si elle ne la mettait pas en cause. En s’estimant plus réceptif aux droits de l’homme, The Circle s’avère être au contraire, en totale opposition avec eux.
![the-circle-il-cerchio-emma-watson[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-il-cerchio-emma-watson1.jpg)
Il est également intéressant d’étudier, dans le film, l’art de la stratégie. Comment les créateurs du système arrivent à convaincre ? En montrant toujours les meilleurs côtés de leurs inventions, tout comme le réalisateur d’ailleurs qui privilégie les avantages de ces avancées en dépit des inconvénients, qu’il cherche pourtant à dénoncer. La sécurité des peuples avant tout, l’espoir donné à ceux qui n’en n’ont plus comme au père de Mae. Grâce à l’intelligence de leurs mots, ils parviennent à toucher le public. Les gens qui n’ont pas accès à certains lieux, certaines activités peuvent les vivre à travers l’image. Mais est ce que les images peuvent réellement remplacer les sensations ? Est ce que les rêves remplacent l’action ? James Ponsoldt laisse plusieurs portes ouvertes, plusieurs débats possibles en gardant toujours un œil et un ton moralisateur. Emma Watson apparaît comme l’actrice idéale dans le rôle de la jeune engagée, porte parole dont l’intelligence et les capacités à faire de grands discours séduisent bien qu’elle ne se montre pas toujours très juste et convaincante.
![The_circle[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/The_circle1.jpg)
Ce duel entre liberté et transparence est également illustré par le tiraillement dont Mae est victime. D’un côté son besoin de liberté et d’avoir un bon travail pour vivre sa vie, de l’autre, son amour pour ses parents, ses amis. Il s’avère alors qu’à un moment donné de l’histoire, les deux deviendront compatibles et tout le monde y trouvera son compte, jusqu’à ce que l’envie d’aller plus loin resurgisse. Avec quelques scènes et histoires qui rappellent l’importance de la vie privée, le réalisateur remet son personnage principal sur le droit chemin mais livre tout de même une vision pessimiste des générations contemporaines.
![the-circle-movie-image-emma-watson-3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-movie-image-emma-watson-31.png)
En présentant ce besoin permanent d’exploiter les technologies à l’excès, en montrant les mauvais aspects de l’humanité aux côtés de l’innovation, The Circle fait réagir le spectateur sur sa propre utilisation de la modernité. Bien que depuis toujours l’on nous apprenne à dépasser les limites, il faut parfois accepter d’en laisser. Le film lance une alerte sur l’omniprésence des réseaux sociaux dans nos vies par la métaphore d’une secte dont le gourou serait la technologie. L’une des scènes finales où l’obscurité est vaincue quand tous les écrans sont tournés vers Mae pour l’éclairer, achève le film sur une note ambivalente qui entrevoit des solutions en demandant de rester vigilants. Bien que la dystopie manque un peu de fond et de profondeur, le message demeure efficace.
![the-circle-movie-trailer-screencaps-emma-watson[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-movie-trailer-screencaps-emma-watson1.png)
The Circle est un bon film parlant de vie privée et publique, réseaux sociaux et interconnexions entre humains.
Une jeune femme brillante est embauchée dans une immense compagnie « The Circle ». Cette dernière s’implique de plus en plus dans cette entreprise souhaitant fusionner tous les comptes utilisateurs en son sein et proposer des services s’immisçant de plus en plus dans la vie privée des gens. On se retrouve donc bientôt en plein cœur d’une spirale de transparence qui concerne beaucoup de personnes, dont une jeune héroïne jouant cela à fond et faisant à un moment basculer le récit dans un genre déjà bien exploité par The Truman Show.
![thecircle-movie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/thecircle-movie1.jpg)
Le film, réalisé et écrit par James Ponsoldt, est une œuvre de science-fiction présentant un futur proche, que, personnellement, j’espère ne jamais voir arriver, dans lequel l’utopie humaniste passe par une complète honnêteté et plus aucun lieu intime secret.
Les éléments de fiction, notamment ces mini-caméras omniprésentes semblant fonctionner de façon autonome très longtemps, sont bien faits.
Les effets spéciaux et décors, comme l’entreprise tentaculaire, personnage à part entière de l’histoire, sont très travaillés et donnent vraiment l’impression de se retrouver dans un univers futur propre et policé.

Les acteurs sont très bons, que ce soit Tom Hanks en patron d’entreprise charismatique, ou John Boyega en développeur de génie ambigu.
Mais c’est vraiment Emma Watson qui porte le film sur ses épaules, et cette dernière y apporte plus de subtilité que dans certains de ses longs métrages précédents.
Toutefois, la démonstration proposée aboutit sur une fin qui me laisse sceptique. Cette dernière est assurément polémique, et devrait ravir certains spectateurs et en décevoir bien d’autres.
![emma-watson-the-circle-movie-photos-and-posters-1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/emma-watson-the-circle-movie-photos-and-posters-11-2.jpg)
The Circle est un film intéressant et une belle démonstration sur la place de plus en plus prégnante des réseaux sociaux dans la vie des gens. Il apporte aussi une réflexion intéressante sur l’essence de l’humanité et la vie privée.
Avec une réalisation bien faite, une histoire captivante, des effets spéciaux très propres et des acteurs convaincants, cette œuvre d’anticipation fait vraiment froid dans le dos.
![The-Circle-2017-Movie-Free-Download-HD-Cam-2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Circle-2017-Movie-Free-Download-HD-Cam-21.jpg)
PETIT BONUS POUR LES COURAGEUX QUI AURONT REUSSIT A LIRE JUSQU’AU BOUT : Ma photo d’Emma Watson prisent par mes soins lors de la projection presse du film à Londres cette année ! Je remercie les deux gorilles de la sécurité de l’approcher de si près puisqu’il était impossible de la toucher, de faire un selfie ou d’être au minimum à 1 mètre d’elle … Mais Emma a eu l’élégance et la classe d’accepter la pose suite à mes demande en m’égosillent dans un parfait Anglais ^^ C’est pour vous, c’est cadeau !

![18360378_120332000643230395_1060316420_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/18360378_120332000643230395_1060316420_n1.png)

![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-300x194.png)
![Super Charlie de Jon Holmberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Super-Charlie-affiche2-100x75.png)
![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-100x75.jpg)

![The Brutalist de Brady Corbet [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Brutalist-affiche-100x75.jpg)
![Red Bird de Alexandre Laugier, Thomas Habibes et Houssam Adili [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Red-Bird-affiche-100x75.jpg)
![Greenland : Migration de Ric Roman Waugh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Greenland-Migration-affiche-100x75.jpg)

![PRIMATE de Johannes Roberts [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Primate-affiche-100x75.jpg)









![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-300x194.jpg)

![Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés de Rian Johnson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Wake-Uo-Dead-man-affiche-100x75.jpg)
![Troll 2 de Roar Uthaug [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Troll2-affiche-100x75.jpg)
![Jay Kelly de Noah Baumbach [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Jay-Kelly-affiche-100x75.jpg)
![Train Dreams de Clint Bentley [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Train-Dreams-affiche-100x75.jpg)
![Le Fils de Mille Hommes de Daniel Rezende [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Le-fils-de-mille-hommes-affiches-100x75.jpg)
![Frankenstein de Guillermo Del Toro [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Frankenstein-affiche-100x75.jpg)

![Carol de Todd Haynes [édition limitée]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Carol-01-100x75.png)
![Eddington d’Ari Aster [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Eddington-affiche-100x75.jpg)

![Thunderbolts* de Jake Schreier [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/09/Thunderbolts-affiche-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Dahomey de Mati Diop](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/06/1695-100x75.jpg)
![Here de Robert Zemeckis [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/03/Here-affiche-100x75.jpg)
![Die Alone de Lowell Dean [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/02/Die-Alone-affiche-100x75.jpg)





![Until Dawn: La mort sans fin de David F. Sandberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/05/Until-Dawn-affiche-100x75.jpg)

![Minecraft, le film de Jared Hess [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/04/Minecraft-Affiche-100x75.png)

























![the_circle_affiche[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the_circle_affiche1.jpg)
![18361741_120332000636629455_1425320810_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/18361741_120332000636629455_1425320810_n1.png)

![the-circle-nuovo-trailer-italiano-del-film-con-tom-hanks-e-emma-watson[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-nuovo-trailer-italiano-del-film-con-tom-hanks-e-emma-watson1-1.jpg)

![the-circle-movie-trailer-screencaps-emma-watson[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-movie-trailer-screencaps-emma-watson1-1.png)
![emma-watson-the-circle-movie-photos-and-posters-1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/emma-watson-the-circle-movie-photos-and-posters-11-2.jpg)
![the-circle-movie-image-emma-watson-3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-movie-image-emma-watson-31-1.png)
![the-circle-movie-emma-watson[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-movie-emma-watson1.png)
![thecircle-movie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/thecircle-movie1.jpg)
![emma-watson-the-circle-movie-image-[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/emma-watson-the-circle-movie-image-1-2.png)
![The-Circle-2017-Movie-Free-Download-HD-Cam-2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Circle-2017-Movie-Free-Download-HD-Cam-21.jpg)
![Emma-Watson-and-Karen-Gillan-in-The-Circle[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/Emma-Watson-and-Karen-Gillan-in-The-Circle1.jpg)
![The-Circle-12[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Circle-121.jpg)
![emma-watson-the-circle-movie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/emma-watson-the-circle-movie1.jpg)
![hero_Circle-2017[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/hero_Circle-20171.jpg)
![20161206183156-thecirclemovie[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/20161206183156-thecirclemovie1.jpg)
![the-circle-il-cerchio-emma-watson[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-il-cerchio-emma-watson1.jpg)
![The_circle[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/The_circle1.jpg)
![the-circle-movie-image-emma-watson-3[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-movie-image-emma-watson-31.png)
![the-circle-movie-trailer-screencaps-emma-watson[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/08/the-circle-movie-trailer-screencaps-emma-watson1.png)

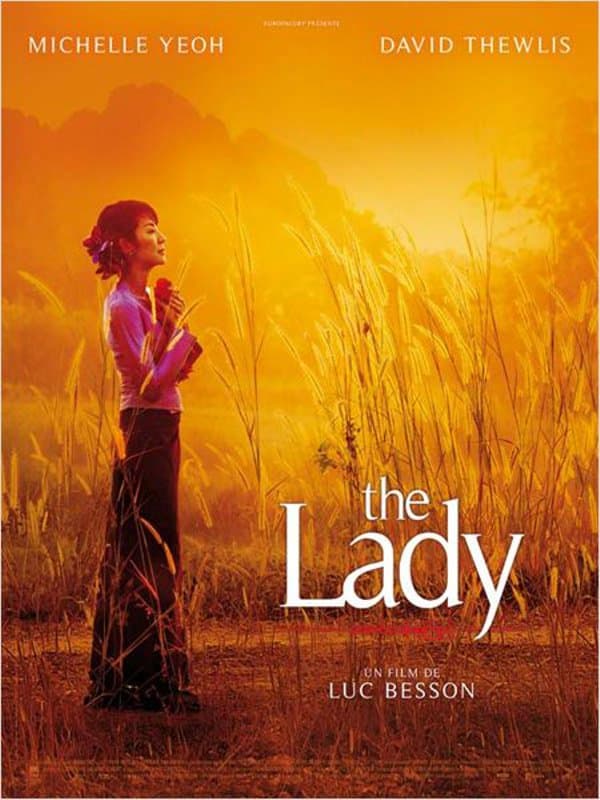

![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18337428_120332000609910654_1254544363_n1-5.png)









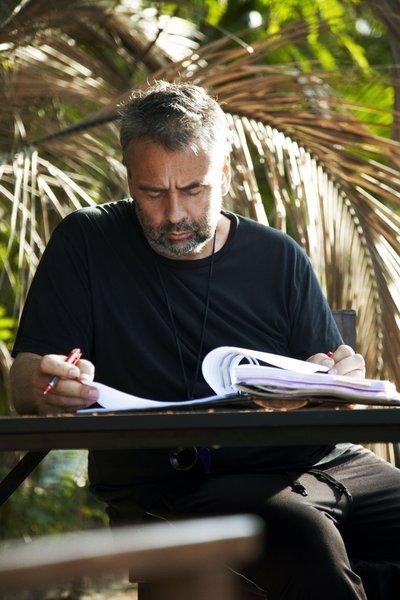


![malavita_affiche_definitive-2[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita_affiche_definitive-21.jpg)
![18361326_120332000654163832_694339731_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18361326_120332000654163832_694339731_n1-1.png)
![untitled-6[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/untitled-61.jpg)
![malavita-dianna-agron[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita-dianna-agron1.jpg)
![malavita-annunciato-cast-parziale-130839-1280x720[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita-annunciato-cast-parziale-130839-1280x7201.jpg)
![malavita1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita11.jpg)
![malavita_1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita_11.jpg)
![malavita_10[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita_101.jpg)
![21017664_20130704171608543[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21017664_201307041716085431.jpg)
![malavita_vostf_thumb115[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita_vostf_thumb1151.jpg)
![488569.ogfb[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/488569.ogfb1_.jpg)
![3795202[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/37952021.jpg)
![21010316_20130604175101355[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21010316_201306041751013551.jpg)
![21010318_20130604175103074[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21010318_201306041751030741.jpg)
![21017666_20130704171609762[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21017666_201307041716097621.jpg)
![21041177_20130918103120078.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21041177_20130918103120078.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![21041178_2013091810312039.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21041178_2013091810312039.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)
![E37cXf4NMdg5reB4anYh4OefWS[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/E37cXf4NMdg5reB4anYh4OefWS1.jpg)
![adelegrd-282c1[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/adelegrd-282c11.jpg)
![18360639_120332000649417132_900260586_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18360639_120332000649417132_900260586_n1-2.png)
![2010-les-aventures-extraordinaires-d-adele-blanc-sec[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/2010-les-aventures-extraordinaires-d-adele-blanc-sec1.jpg)
![357529-louise-bourgoin-dans-les-aventures-opengraph_1200-2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/357529-louise-bourgoin-dans-les-aventures-opengraph_1200-21.jpg)

![les-aventures-extraordinaires-dadele-blanc-sec[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/les-aventures-extraordinaires-dadele-blanc-sec1.jpg)
![les-aventures-extraordinaires-d-adele-blanc-sec[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/les-aventures-extraordinaires-d-adele-blanc-sec1.jpg)
![les-aventures-extraordinaires-d-adele-blanc-sec_1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/les-aventures-extraordinaires-d-adele-blanc-sec_11.jpg)
![Les-aventures-extraordinaires-d-Adele-Blanc-Sec-NT1-que-devient-Louise-Bourgoin-Photos_exact1024x768_l[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Les-aventures-extraordinaires-d-Adele-Blanc-Sec-NT1-que-devient-Louise-Bourgoin-Photos_exact1024x768_l1.jpg)
![Louise-Bourgoin-dans-les-aventures-extraordinaires-d-Adele-Blanc-sec_square500x500[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Louise-Bourgoin-dans-les-aventures-extraordinaires-d-Adele-Blanc-sec_square500x5001.jpg)

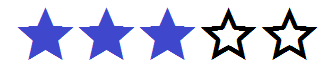
![7a03wloYdR1qVlNgxGuprD6HjdG[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/7a03wloYdR1qVlNgxGuprD6HjdG1.jpg)
![70e50a8a719aa9d2a3b1088bcd3b8024cc7fc392[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/70e50a8a719aa9d2a3b1088bcd3b8024cc7fc3921.jpg)
![1357149[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/13571491.jpg)
![1831079[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18310791.jpg)
![1831082[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18310821.jpg)
![Arthur_20-940x435[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Arthur_20-940x4351.jpg)
![ARTHUR+3+LA+GUERRE+DES+DEUX+PHOTO1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ARTHUR3LAGUERREDESDEUXPHOTO11.jpg)
![ARTHUR+3+LA+GUERRE+DES+DEUX+PHOTO5[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ARTHUR3LAGUERREDESDEUXPHOTO51.jpg)
![mK1kfmNmGI5bBzbtKTfWuVt7szJ[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/mK1kfmNmGI5bBzbtKTfWuVt7szJ1.jpg)
![f3v6fXnSl0P51KYRRVb9bWvVHI1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/f3v6fXnSl0P51KYRRVb9bWvVHI11.jpg)
![arthur-et-la-guerre-des-deux-mondes.20170228030708[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/arthur-et-la-guerre-des-deux-mondes.201702280307081.jpg)
![hv7R0mug2ikYk7DAfWeZ5v9DlWf[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/hv7R0mug2ikYk7DAfWeZ5v9DlWf1.jpg)
![arthur-et-la-guerre-des-deux-mondes-1457002144[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/arthur-et-la-guerre-des-deux-mondes-14570021441.jpg)
![arthur_def-4ba6c[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/arthur_def-4ba6c1.jpg)
![18361326_120332000654163832_694339731_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18361326_120332000654163832_694339731_n1.png)
![w1152_h648[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/w1152_h6481.jpg)
![uPNBxTuHUX3wjdgYxp1CIOcNoj8[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/uPNBxTuHUX3wjdgYxp1CIOcNoj81.jpg)
![scr-6[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/scr-61.jpg)
![o9jFMgSZfW3OJiy0QrtkGuPvnLW[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/o9jFMgSZfW3OJiy0QrtkGuPvnLW1.jpg)
![ME0001149328_2[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/ME0001149328_21.jpg)
![arthur-et-la-vengeance-de-maltazard-2009-16641-1975406261[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/arthur-et-la-vengeance-de-maltazard-2009-16641-19754062611.jpg)
![arthur-et-la-vengeance-de-maltazard-2009[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/arthur-et-la-vengeance-de-maltazard-20091.jpg)

![73215_cfcb8810904062d2e6d3865df0499150[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/73215_cfcb8810904062d2e6d3865df04991501.jpg)
![arthur-et-la-vengeance-de-maltazard.20170303013004[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/arthur-et-la-vengeance-de-maltazard.201703030130041.jpg)
![6925[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/69251.jpg)
![8rrLtSM3zofoMhN6Y9dmCO1eHnH[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/8rrLtSM3zofoMhN6Y9dmCO1eHnH1.jpg)
![arthur_minimoys-fa572[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/arthur_minimoys-fa5721.jpg)
![arthur-et-les-minimoys-2006-29-g[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/arthur-et-les-minimoys-2006-29-g1.jpg)
![arthur-et-les-minimoys-2006-05-g[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/arthur-et-les-minimoys-2006-05-g1.jpg)
![Arthur-et-les-Minimoys_width1024[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Arthur-et-les-Minimoys_width10241.jpg)
![arthur-et-les-minimoys-2006-28-g[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/arthur-et-les-minimoys-2006-28-g1.jpg)
![Arthur-3-la-guerre-des-deux-mondes_width1024[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/Arthur-3-la-guerre-des-deux-mondes_width10241.jpg)
![spider-man_1-1496c[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/spider-man_1-1496c1.jpg)
![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18337428_120332000609910654_1254544363_n1-4.png)
![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-100x75.png)

